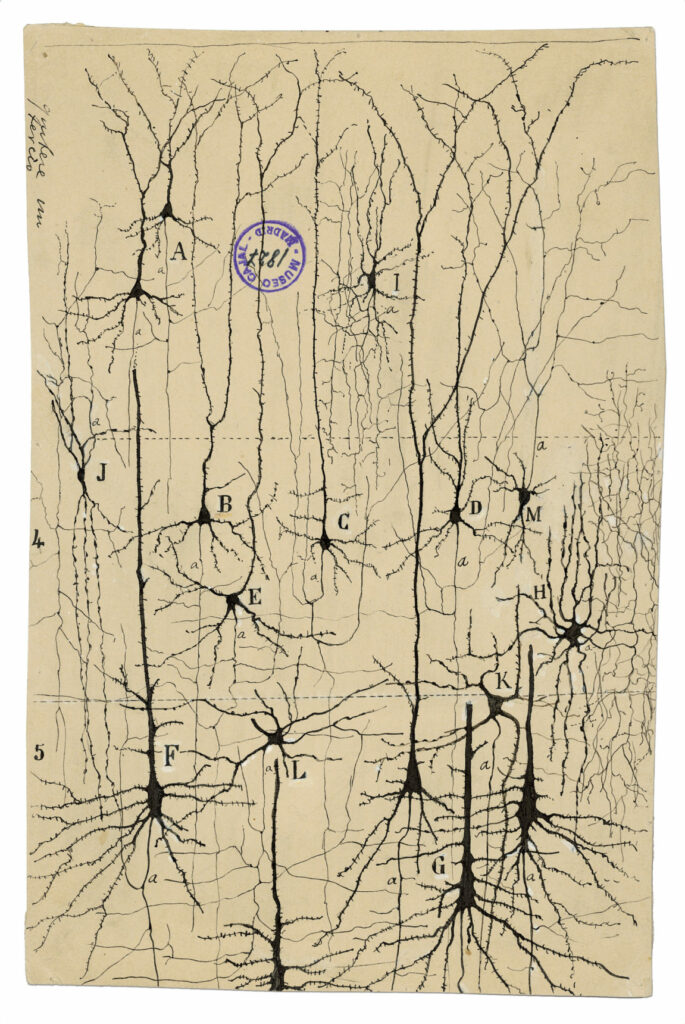
Lorsque j’arrive à l’aéroport de São Paulo, j’ai la gueule de bois d’avoir passé les deux dernières semaines ivre, pas que de Malbec, mais surtout de vent et de gens. J’ai du sable de la pampa partout. Dans les oreilles malgré les douches, dans tous les interstices de mon portefeuille, dans les coutures de mon sac, dans les chaussures, le téléphone. J’ai le coeur ridiculement ensablé des multiples découvertes humaines. Ces gens. Cette richesse, ces histoires vraies de la vie.
Les petits-déjeuners avec Ralph. M’échapper avec T. d’une session de présentations, aller faire voler son drone au soleil couchant ; ensemble contempler dans un silence serein les nuages-soucoupes et les longues ombres des touffes d’herbes dans la pampa depuis son oiseau mécanique à cent mètres d’altitude. Sentir ma main toute petite, serrée fort entre celles d’un collègue allemand, les yeux rougis par quelques compliments. Dans un bureau, pendant deux heures écouter une belle argentine déverser sa vie, sa fille, le père de sa fille, et toutes les joies et difficultés qui vont avec. « Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? » s’arrête-t-elle d’un coup. Je me retiens de lui répondre : Oh c’est simple, comme dirait ma sœur, je dois dégager des phéromones cette semaine. La preuve ultime : pendant tout le dîner de collaboration Auger, un chat est resté accroché à mon siège.
À ce dîner, I. me confie, dans la pénombre, sous les arbres et à côté des moutons, dans l’odeur d’asado qui imprègne mon manteau : « Je crois que j’aime trop les gens. Ma mère me disait toujours d’arrêter de faire confiance. Mais on peut me blesser encore et encore, et toujours je finis par pardonner et trouver des excuses. » Je réponds que dans une certaine mesure, je suis comme ça aussi. Je sais les gens un peu noirs, un peu blancs, un peu gris. Et j’aimerais me concentrer toujours sur la partie blanche. Elle me sourit : « Exactement. Et tu sais, quoiqu’on en dise, je n’ai pas envie de perdre ça. » Je l’embrasse : mais oui, tu as raison. Il ne faut pas perdre ce regard, c’est notre qualité et non une faiblesse.
Je me rassois à côté de T. qui entre temps a fini son dessert. Plus tard, il m’attend pendant que je dis au revoir à tout le monde, dans d’étranges embrassades. Ralph me souffle : 7h demain pour le petit-déjeuner. T. et moi rentrons seuls sur une piste sableuse, dans la nuit noire. Il est une heure du matin. Orion comme un guide devant nous. Nous parlons de nos enfants et de choses sans importance, nous rions beaucoup. Il y a cette connexion douce qui nous soulève.
Je ne me lasse pas de voir les façades se morceler et révéler ce qui compte, au moment de ces ponts qui se tissent. La partie blanche et profonde des gens, qui me laisse surprise, éblouie, nourrie.