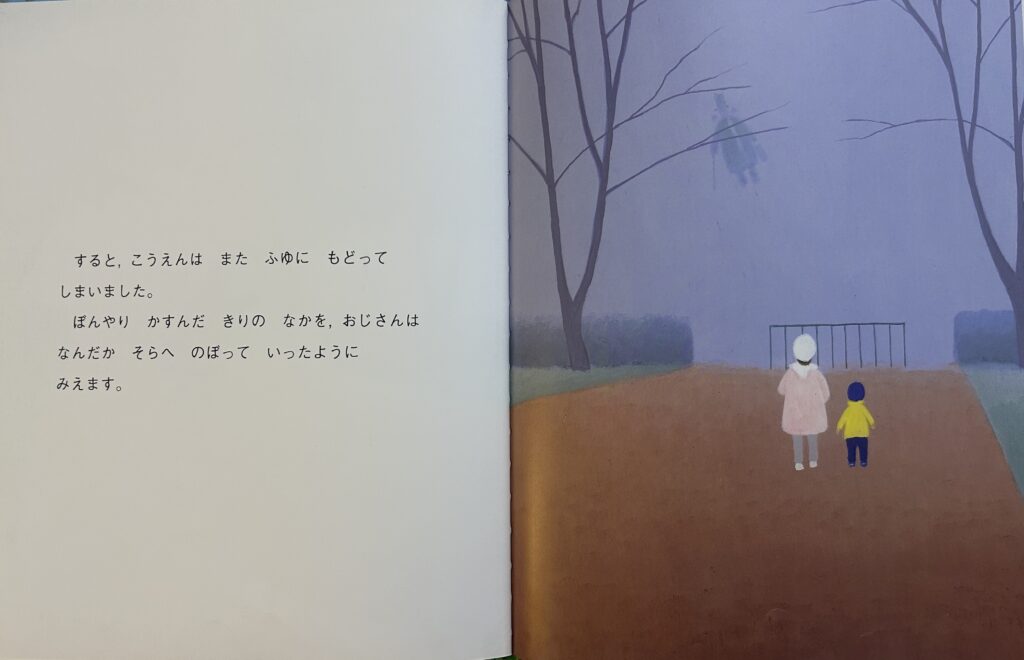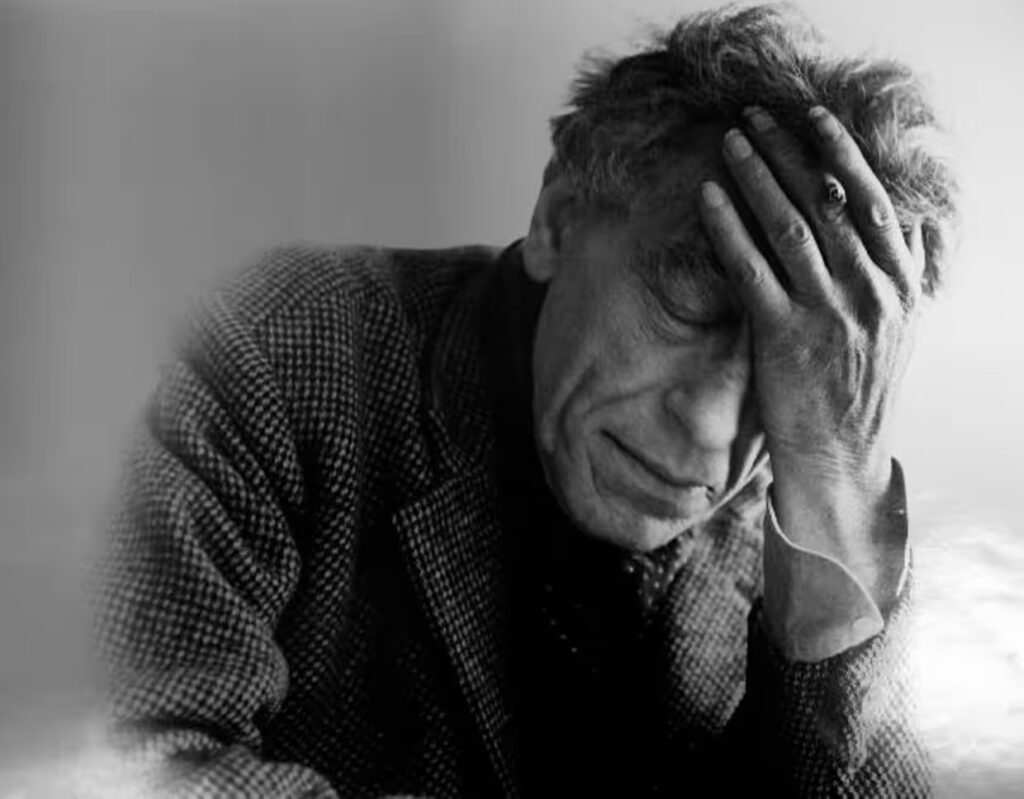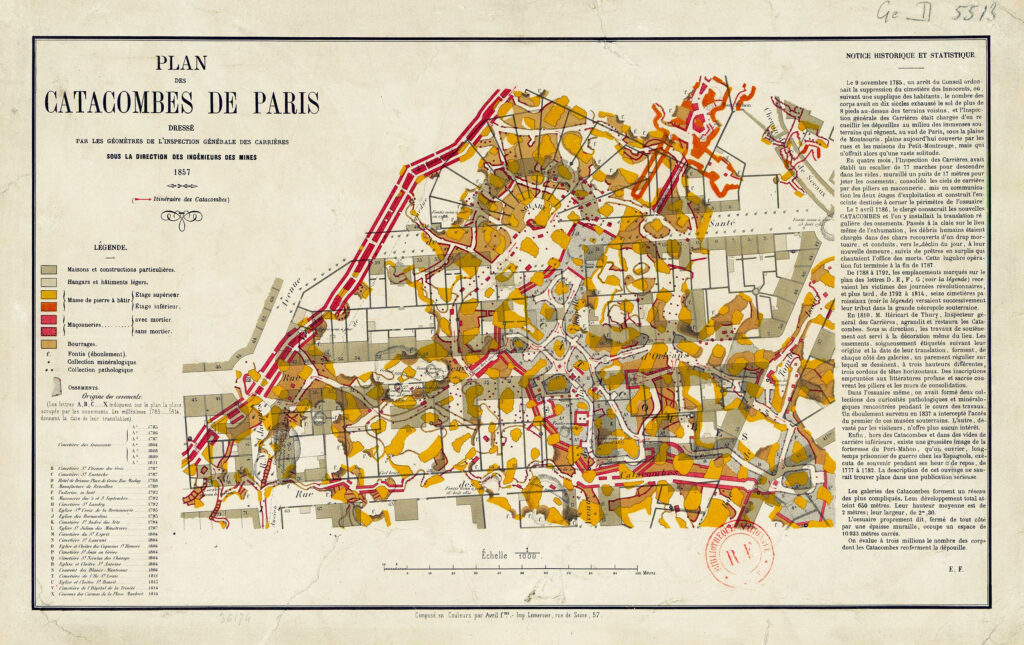Curieux, le froid qui s’engouffre à l’aube des fêtes, à l’aube de l’hiver, à l’aube de la sortie de mon livre.
La dernière entrevue avec mon attachée de presse et mon éditeur m’a rappelé que les genres ne se mélangent pas, que j’ai écrit un livre de science et que le style, la narration importent peu. Ce qui importe, c’est tout ce qui est artificiel pour moi : le bling bling de l’univers violent. J’ai accepté ce pitch-là et je le vends, je l’ai joué, je le jouerai et le vendrai dans les entretiens.
Dans les entretiens, je serai astrophysicienne. Celle imaginée par le public.
Mais ce n’est pas cela que je veux être.
Ce n’est pas cela que je veux être, et ce n’est pas non plus directrice de mon laboratoire que je veux être. Un chercheur au café, me glissait « Tu l’as voulu. » puis voyant ma moue, a corrigé « Tu as consenti en tous cas. » Oui. J’ai consenti.
J’ai consenti et c’est trop tard, mais ai-je encore une fois été faible ou me suis-je cru surpuissante ? Les deux probablement.
Le froid, cette impression que je vais encore une fois traverser un désert. Désert de glace, désert d’écriture, car si je ne suis pas lue, à quoi bon écrire, et puis de toute façon, à quoi bon écrire car comme disait Sylvia : Can I write?
Can I write? Will I write if I practice enough? How much should I sacrifice to writing anyway, before I find out if I’m any good? Above all, CAN A SELFISH, EGOCENTRIC, JEALOUS, AND UNIMAGINATIVE FEMALE WRITE A DAMN THING WORTHWHILE? Should I sublimate (my how we throw words around!) my selfishness in serving other people- through social or other such work? Would I then become more sensitive to other people and their problems? Would I be able to write honestly? Then of other beings besides a tall, introspective adolescent girl? I must be in contact with a wide variety of lives if I am not to become submerged in the routine of my own economic strata and class.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath, orig. published 1982
Tout est dit, pardon, tout est écrit ; comme toujours avec Sylvia.
Alors, cette mauvaise écriture, y a-t-il seulement un sens à essayer de l’entretenir ? À ne pas être lue mais à cracher ici pour continuer à étaler ma bave de mots dans des filaments visqueux ? Trop lyrique, précieuse, baroque, lorsque le partage n’existe plus, lorsque je suis seule à causer, est-ce qu’un jour j’écrirai ce livre qui sera publié et surtout lu, ce livre qui n’est pas juste un instrument de science ? Est-ce que j’ai une quelconque poésie en moi qui va au-delà du narcissisme, est-ce que ça résonne ailleurs ? Est-ce que comme toujours, je ne suis que montée sur mes grands chevaux, avec mes grands mots et mon mélo, à croire que j’habille des clichés avec une quelconque touche d’originalité ?
Chère Sylvia, je ne sais pas si j’aurai le courage ni la force d’être tout ce à quoi j’ai consenti et ce qui est attendu de moi. Et au milieu de tout cela, de réussir à être ce que moi, je souhaite, ce que je désire être, et qui ne bénéficie à personne. À personne d’autre qu’à moi-même.
Chère Sylvia. Si tout est raté, il y a toujours ça : les serviettes, le calfeutrage tout autour de la porte, le four comme ami, et pop. Ce moment où la pensée rencontre le geste. Si tout est raté, ma chère, la bipolarité nous sauvera de tout.
Son : Alex Baranowski, Jess Gillam, Jess Gillam Ensemble, Reflections, 2023