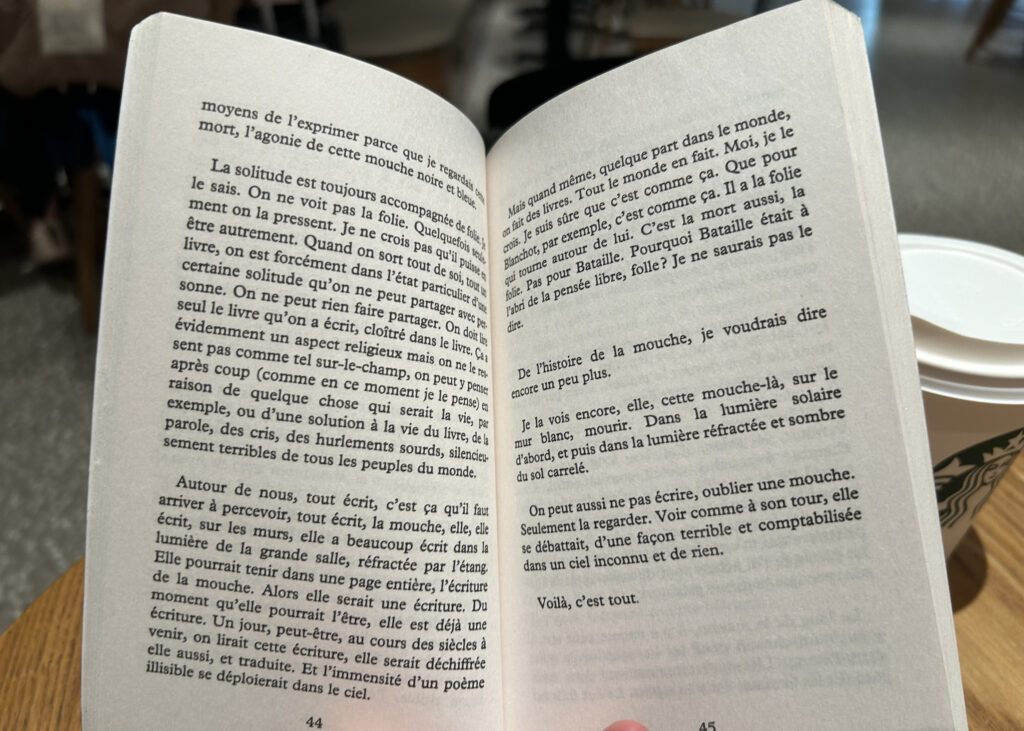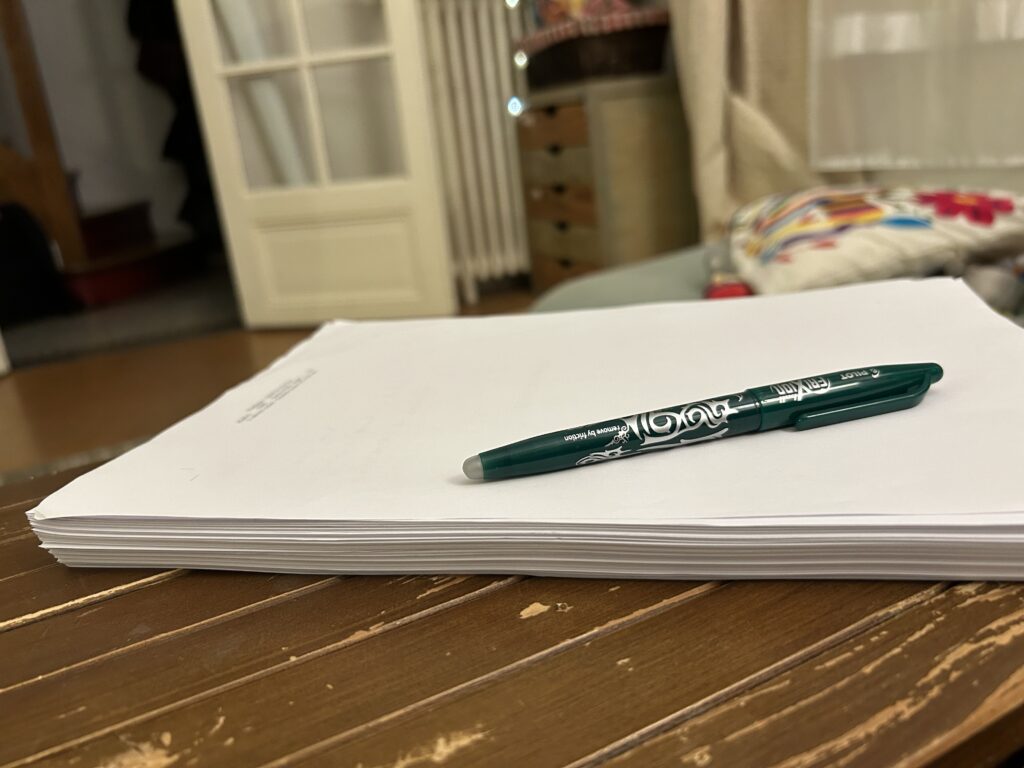De retour de la Comédie française, dans la zébrure des phares sur le périphérique, je songe à Roxane et à cette défaillance de recevoir de la beauté, à vous seule destinée, créée pour vous, un peu par vous.
J’ai vécu cette défaillance.
C’est une défaillance. Une attaque cardiaque. Un manque d’air et de sang et la propulsion dans un autre univers qu’on ne savait pas. Plus jamais on n’est la même, après cela.
Et probablement de l’avoir vécu, je devrais être comblée, être certaine d’avoir touché l’essence de la vie.
Cette essence, elle ne peut être que courte et éphémère, comme chez Cyrano, interrompue fort à propos deux fois par la mort. Il doit y avoir un obstacle qui rend ces défaillances impossibles à filer, ces battements impossibles à soutenir dans le temps. Ces beautés offertes, elles doivent l’être dans l’ombre et dans la surprise, dans des langueurs transitoires et tragiques. Dans des étiolements mais qui ne choient pas dans la routine, dans les forces puisées dans des attentes vaines, dans une sérénité métastable aux chatoiements soudains. Dans les constances inconstantes.
Voilà ce qui a été vécu, et qui ne pouvait être sinon. Pendant si longtemps je n’ai pas compris, comment les empreintes de nos mains fluctuaient de leur encre. Le rôle joué par celle qui fermait les passerelles. Pourquoi j’avais été mise dans un placard pieds nus, après avoir été nourrie comme une princesse grecque.
C’était la version moins dramatique que la mort.
Nous pensions – tu pensais – sauver le quotidien. Être de ceux raisonnables qui prennent la ligne classique de droiture. En réalité c’est le grand théâtre de la vie qui se jouait en nous, en dehors et au cœur de nous, sa façon à elle de protéger la beauté, de garder intact l’éclat des sons, la lumière des mots entrelacés d’images. Nous pensions subir la réalité et c’est la grâce de la pièce qui a coulé sur nous.
J’ai compris maintenant, et je chéris cette distance qui protège la défaillance, celle qui a été, celle qui dans le futur reste quantique, probabiliste. La distance qui permet de donner corps sans corps, à des mots sans mots, à des messages qu’on sait existants mais que l’on n’ouvre pas, afin qu’ils restent sous forme d’esprits et de pétales.
À l’ellipse.
À l’éphémère qui ne l’est pas, mais l’est par nécessité.
À la beauté qui nous lie, à l’instant où on la rencontre, car nous sommes alors l’un pour l’autre notre première pensée.