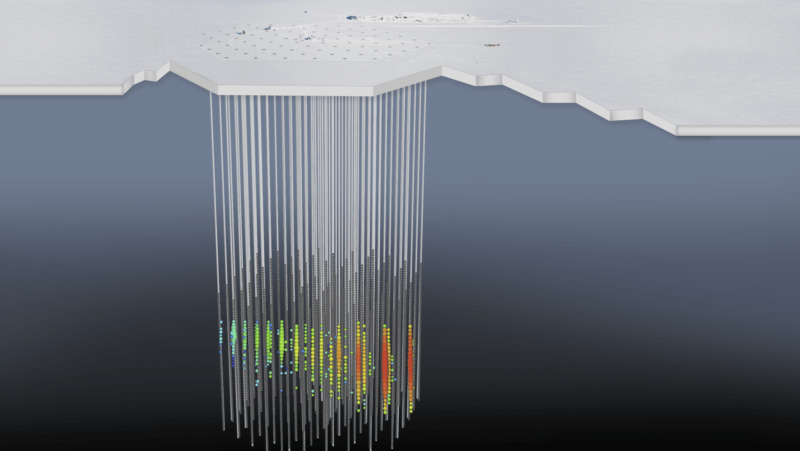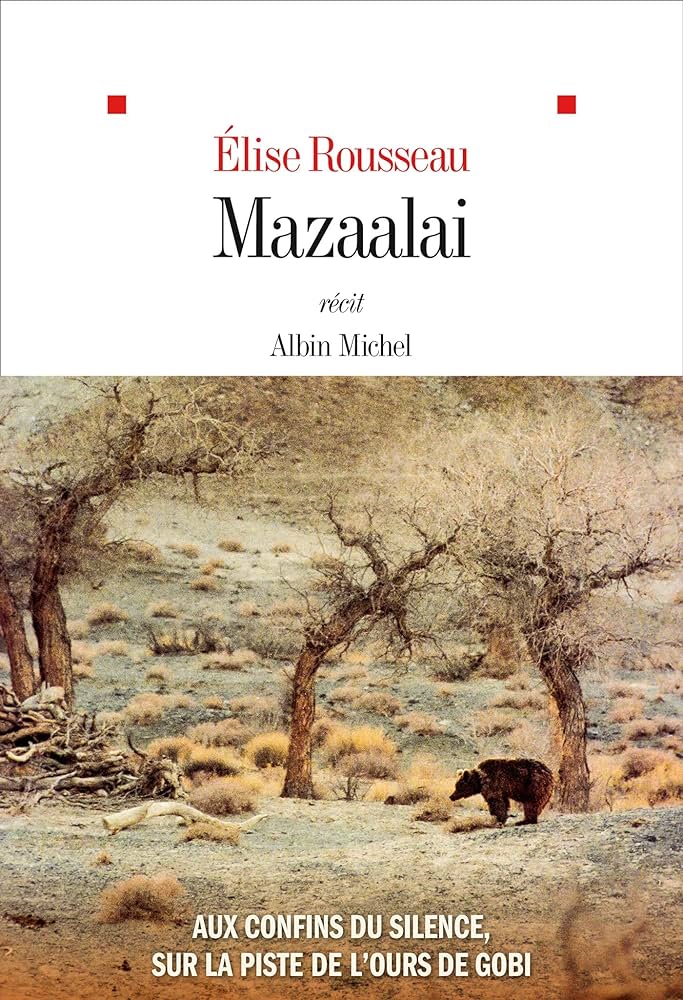C’est quand même bizarre le pouvoir du lâcher prise. Physiquement, je suis toujours au bord du malaise vagal permanent. Mentalement, je décide enfin de lâcher prise. Le soir venu, je me lave le cerveau : je passe trois heures à scanner des robes sur Vinted, j’en achète six, je regarde Dune, je bois du whisky, je lis Murakami et Beauvoir.
Et le lendemain matin, comme je m’assois au café avec un raspberry scone et que j’expédie tranquillement les taches administratives qui me saoulaient…
J’ai enfin mon chapitre 9.
D’un coup, tout fait sens. Les heures à voir et revoir des scènes de Funny Face [et ne pas être d’accord, malgré Audrey Hepburn], à poursuivre Sartre dans des bars à jazz enfumés de Saint Germain, à ne rien comprendre à l’existentialisme, à errer entre sa préface à un catalogue de mobiles de Calder, à chercher des découpages de Matisse. Je découvre que Simone avait son premier appartement d’émancipée à Paris exactement à cinquante mètres de mon institut, elle parle bien sûr de Sartre – comme d’une sorte de work-spouse [il faudra faire un billet dédié là-dessus] – et desdits cafés/bars enfumés. Éplucher les articles du Monde de 1967, la guerre de six jours, le Vietnam, tomber sur un article sur Le Diable et le Bon Dieu. Entendre Pierre Brasseur jouer Kean sur France Culture. Quand j’ouvre Profession romancier de Murakami, y lire son évocation de la révolte étudiante de 68. Au fil des nuits, doucement, la mise en place de cette convergence. Mais le fil m’échappait encore, je me débattais avec acharnement, il m’échappait parce que je le cherchais.
Alors une fois le cerveau rincé.
C’est arrivé tout naturellement. Et au moment où c’est là, c’est une évidence.
Et une délivrance.
Le soleil de printemps qui chauffe l’air à 22 degrés.
La couleur des crocus et des jonquilles.
Inévitablement, les choses convergent dans la vie – comme c’est rassurant, et comme c’est formidable.
Son : Sufjan Stevens renoue avec la poésie éthérie et ses finales en envolées symphonico-électroniques de ses anciens albums. Même si l’allusion à Jésus ne me parle pas, après tout, on appelle ça comme on veut : Everything That Rises, in Javelin, 2023.