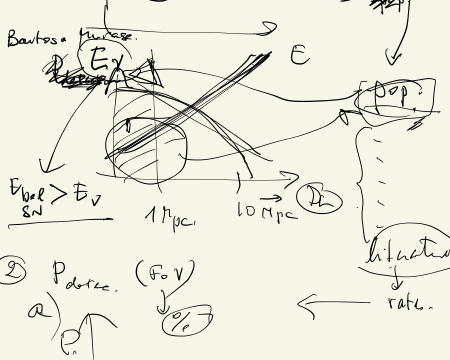Marrant : c’est lorsque je suis dans les rayons du Walmart, en train d’acheter un carton de déménagement, que je me rends compte de l’évidence. Nous quittons l’Amérique. Mon Amérique facile, mon Amérique pragmatique, celle de l’immédiateté, de l’énergie à revendre, où il y a juste à tendre les mains pour saisir les opportunités, celle folle et coulante, celle qui préfère les compromis et croit en ses tabous. Mon Amérique, critiquée et aimée, sa chaleur abêtissante et ses intérieurs sur-glacés ou sur-chauffés dans des hivers blancs. Sa nourriture sur-salée sur-grasse sur-épicée pour compenser la hâte de grignoter plutôt que de savourer, ses gens qui vous embrassent et vous oublient aussitôt, et le plaisir d’être d’ailleurs et d’ici à la fois, de n’être jamais ancré nulle part, la gratuité des interactions et des actions, avec une pression sociale réduite à un fil, apprécier les instants comme ils passent, sans le poids des futurs fluctuants et plein d’options.
Je n’ai en moi ni pleurs ni mélodrames, je suis habitée et pleine, heureuse de cette aventure, nous voguons de port en port, de minéral en minéral, j’espère que c’est ce que les enfants auront appris cette année : que nous pouvons partir, revenir, repartir, la puissance de la liberté, que la vie s’écrit et se saisit dans les géographies. Pour cette exploration, l’importance des quelques cristaux humains qui se gardent dans la poche, qui nous gardent dans le fondamental, qui nous rattachent aux différentes facettes que nous sommes, et qui font que jamais nous ne nous perdons, dans cette merveilleuse errance.
Son : Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer, Chris Thile, Attaboy, in Goat Rodeo Sessions, 2011