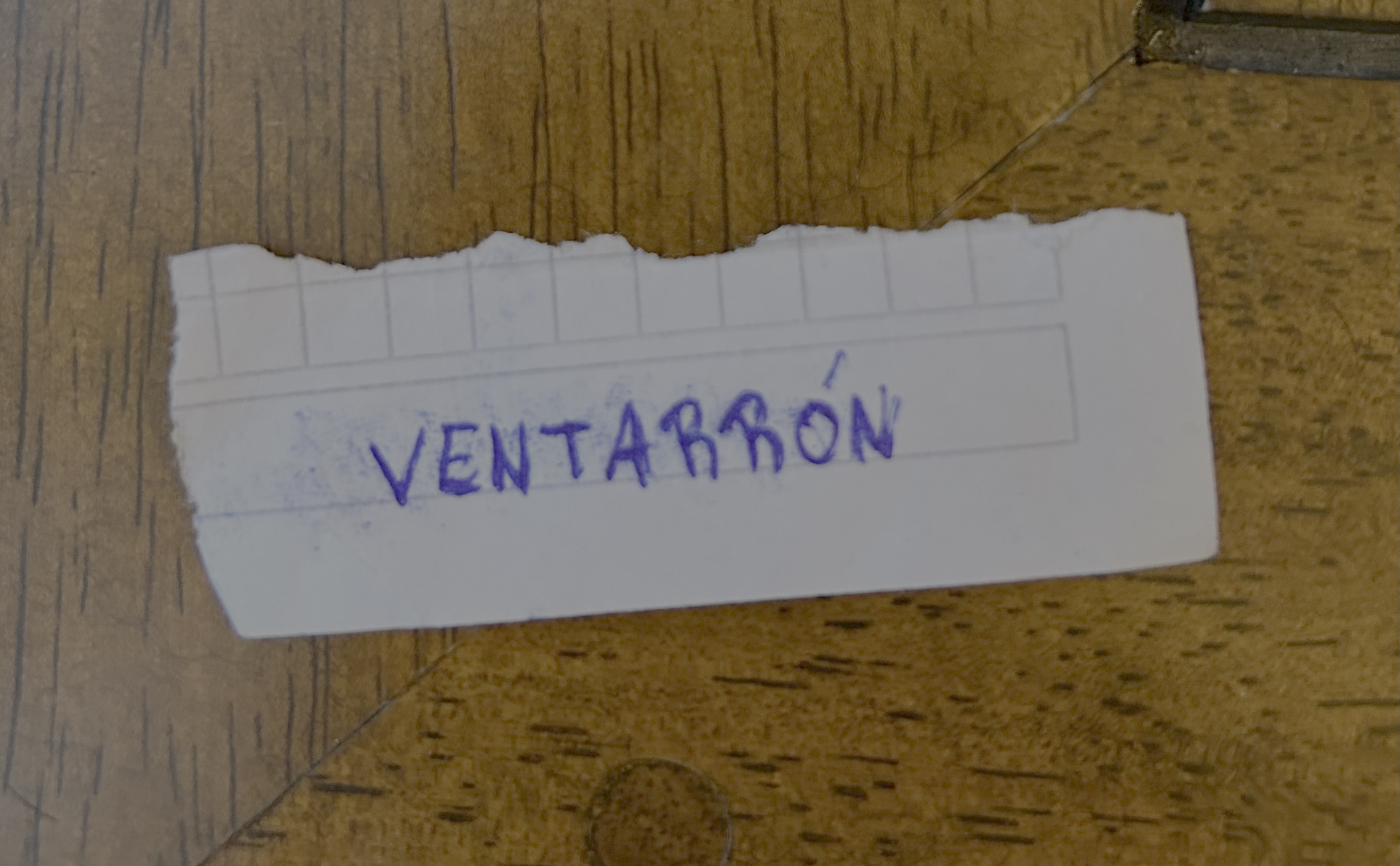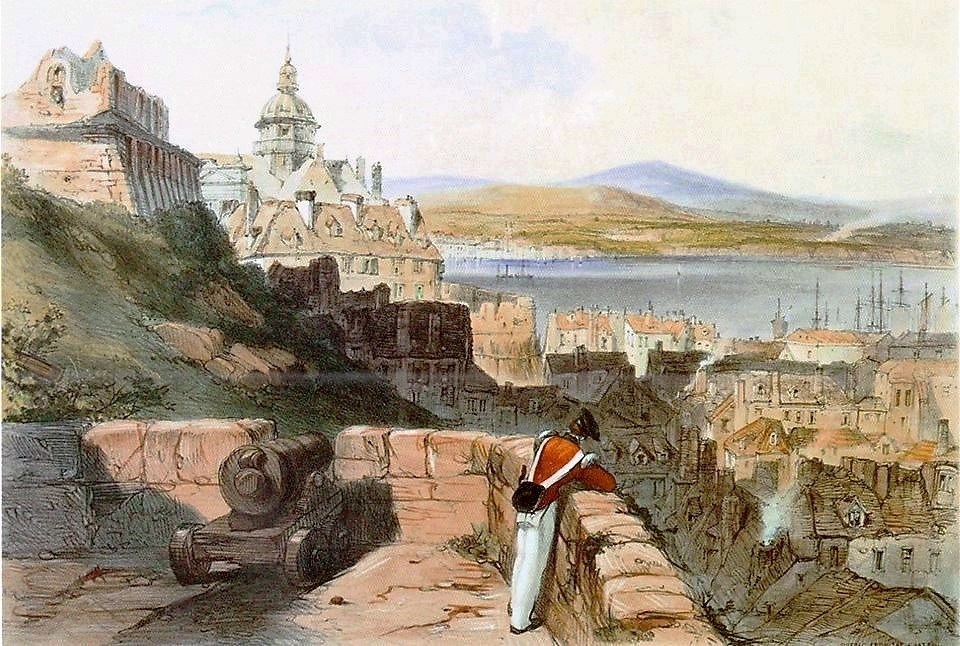À l’ombre d’une entrée haussmannienne du 14ème arrondissement, dehors le printemps et le ciel bleu, j’ai fait l’école buissonnière ; derrière lui, je vois la rangée de boutons pour l’interphone, j’ai rendez-vous au second dans trois minutes exactement, le flat white éthiopien a torréfié ma bouche, il ruisselle d’une série de mots à la désuétude romanesque, comme s’il les avait chinés. Je pense : on pourrait être à Buenos Aires, le fer forgé au bois patiné, les miroirs et les mosaïques au sol, et le tango : cadence méditative et quasi-érotique de nos paroles qui filent la pulsation éclatante et douce de la vie.
Et j’échappe cette notion – je dis : « Ce que j’envisage et souhaite construire ici se prolonge sans limite. »
Déclaration naturelle et inattendue qui me laisse ensuite plusieurs jours dans une sidération apaisée. J’avais – par pragmatisme et par désaffection – longtemps pris l’habitude d’avancer en jalons, en prévisionnels aux dates arrêtées, en calendriers mensuels et quinquennaux.
Je suis dans le monde et la vie et cela ne m’effraie pas. Ce monde qui se morcelle, l’attente lente d’une société chloroformée, anxieuse, ce qui couve et déchirera notre existence actuelle, je m’y prépare sans angoisse. Je vis au rythme de la lumière qui glisse sur les façades comme des à-plats de couleur, je vis aux parfums qui s’enroulent, et j’embrasse dans le chaos rampant, les grains de vie aux notes de café qui pointillent les chemins à suivre.
Son : Sérgio & Odair Assad, Ausencias, in Sérgio & Odair Assad Play Piazzolla, 2001.