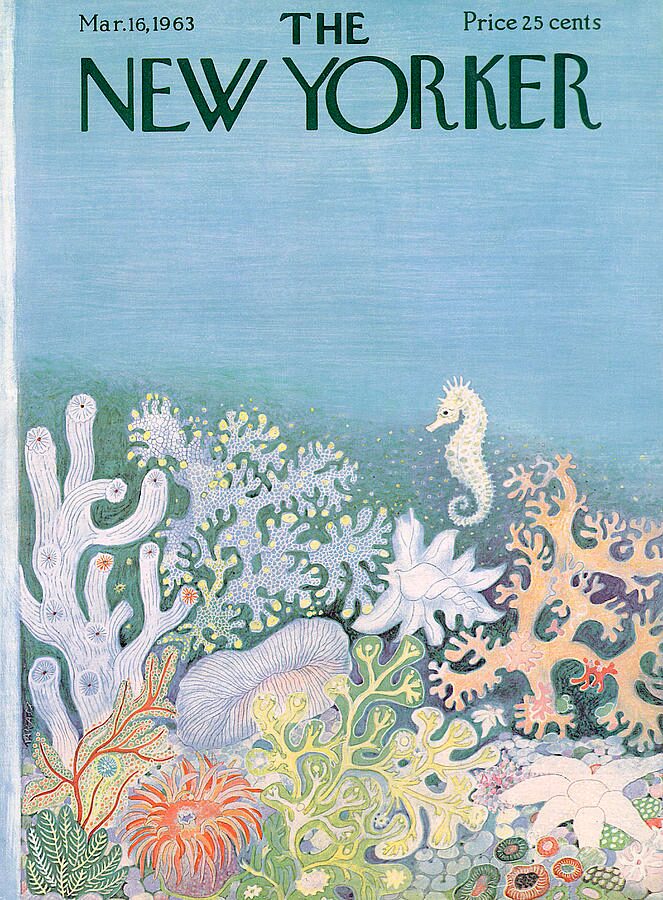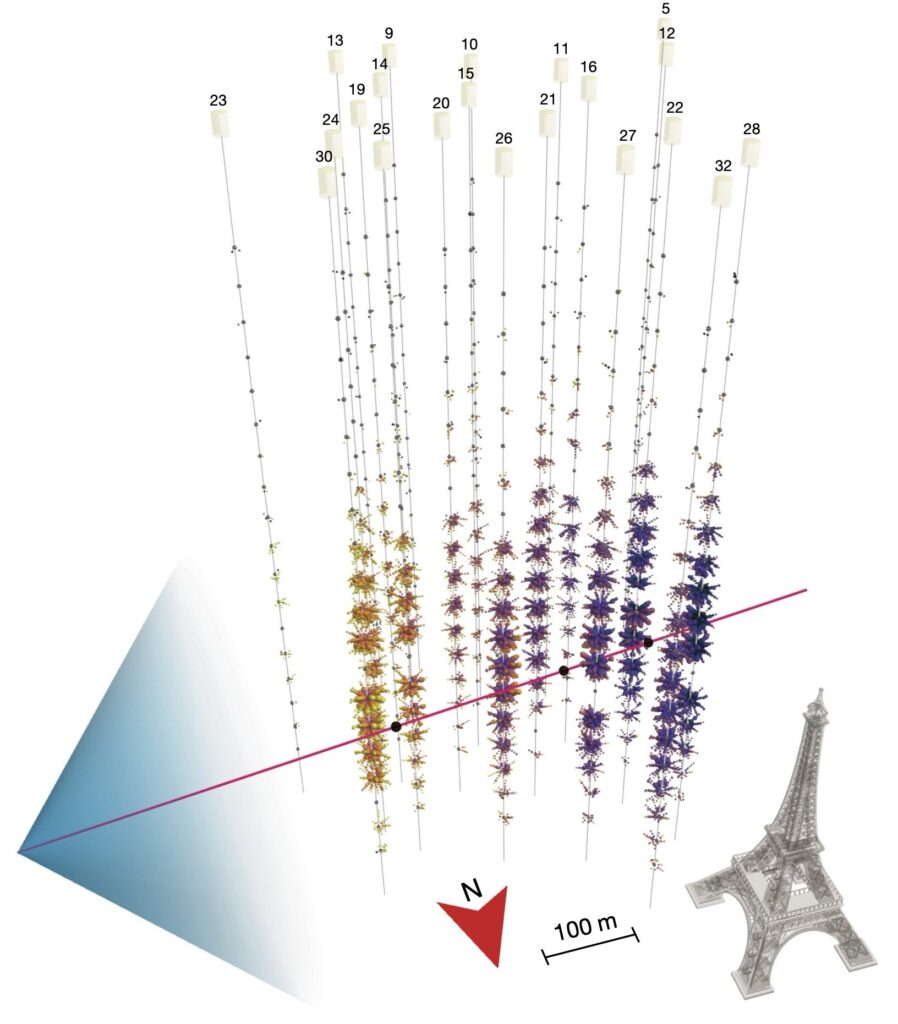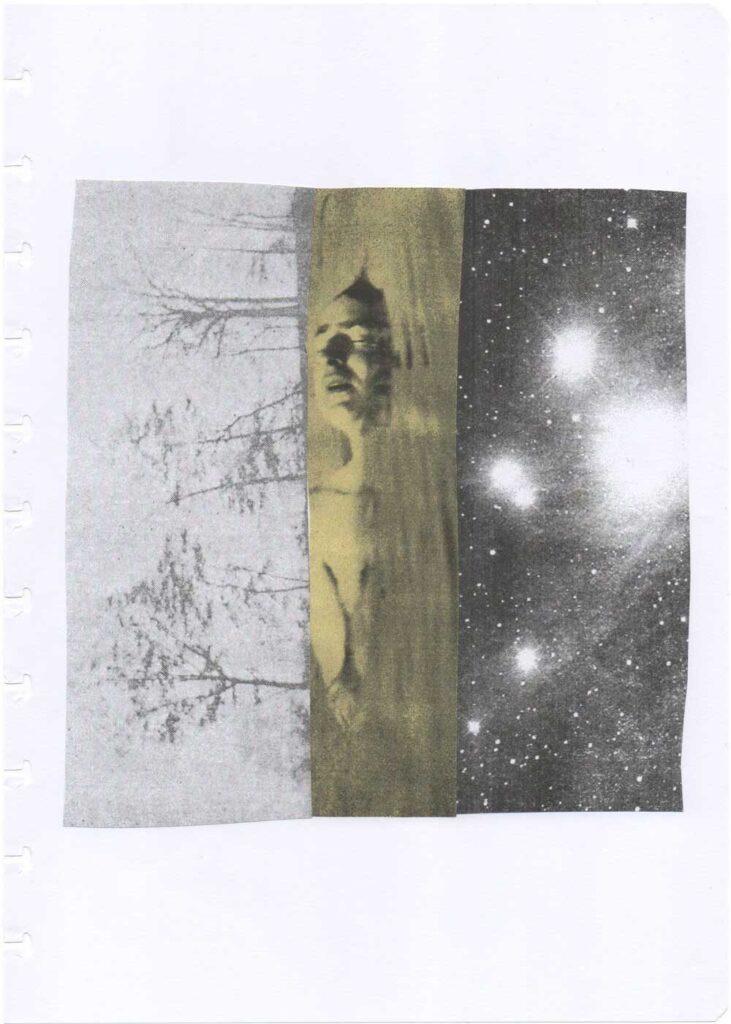Ce qui devait arriver arriva. À force de jouer à l’astrophysicienne, à la femme chercheuse, à la directrice, à la porte-parole du projet international G, à l’autrice… , sur les ondes et devant des journalistes. Ce jeu que je jouais contrainte et forcée, parce que mon attachée de presse m’avait déniché toutes ces belles plateformes, et que mon éditeur me disait de ses yeux bleus : « c’est un peu ton job », ce jeu-là. Jeu qui me désolait il y a encore trois mois, dans le travestissement que cela impliquait.
Jouer ! Est-ce que je sais, moi, quand je joue ? Est-ce qu’il y a un moment où je cesse de jouer ? Regardez-moi : est-ce que je hais les femmes ou est-ce que je joue à les haïr ?
— Alexandre Dumas, adaptation de Jean-Paul Sartre, Kean, 1953
dit Edmond Kean à Anna Damby, dans cette affectueuse joute anti #metoo (à première vue, à discuter…), qui m’a toujours délectée.
À force de le jouer. Vous savez comment ça se passe [avec moi] : l’habit, il finit par s’incruster dans la peau, et plutôt tôt que tard. Peut-être parce que dans tout cela, la part de celle qui écrit n’a pas fini au vestiaire, que PB l’a révélé de façon fracassante dans son article, pour que je puisse l’aborder sans craindre le strip-tease. Peut-être parce qu’on m’a rappelé que le sourire s’entendait à l’antenne, peut-être parce que j’ai en parallèle accueilli N. au laboratoire, et en me demandant comment le marquer, me suis rappelé Maya Angelou – que seule l’émotion reçue reste gravée. Peut-être qu’au contact successif des personnes qui m’entourent et celles que j’ai croisées, les lignes se sont posées, et j’ai su, mieux, ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais être, en accord avec ce qui m’habitait.
Il y a trois mois, j’étais petite et dans le noir, et cela me paraissait insurmontable, de jouer, encore moins d’être, toutes ces étiquettes que j’avais désirées ou acceptées. Aujourd’hui tout se répond, en dehors et à l’intérieur de moi, et me semble d’une étrange justesse.
À force de le jouer, je suis devenue tout cela. Autrement dit, tout est devenu… naturel ? Y compris le partage de ces parties de moi à qui voudra dans le public, avec toutes mes erreurs et mes hésitations, mes émotions, mes défauts. Qu’importe, je ne me cache plus et tant pis pour mes limites cérébrales, j’exprime, je me plante, je ris, et je donne. C’est un peu ça, je crois, être femme, être autrice, être chercheuse et être humaine.
Son et images : Pour remonter le niveau de ce billet en format dégoulinade avancée, la grâce espiègle et la musique viscérale de Martha Argerich, interprétant de Chopin, la Polonaise N°6 As-Dur op. 53, « Héroïque », 1965. [Note : pas lu Emmanuel Carrière, qui paraît-il a écrit sur cette séquence, et qu’il me semble non advenu d’invoquer pour justifier ce moment de musique, de féminité et de partage.]