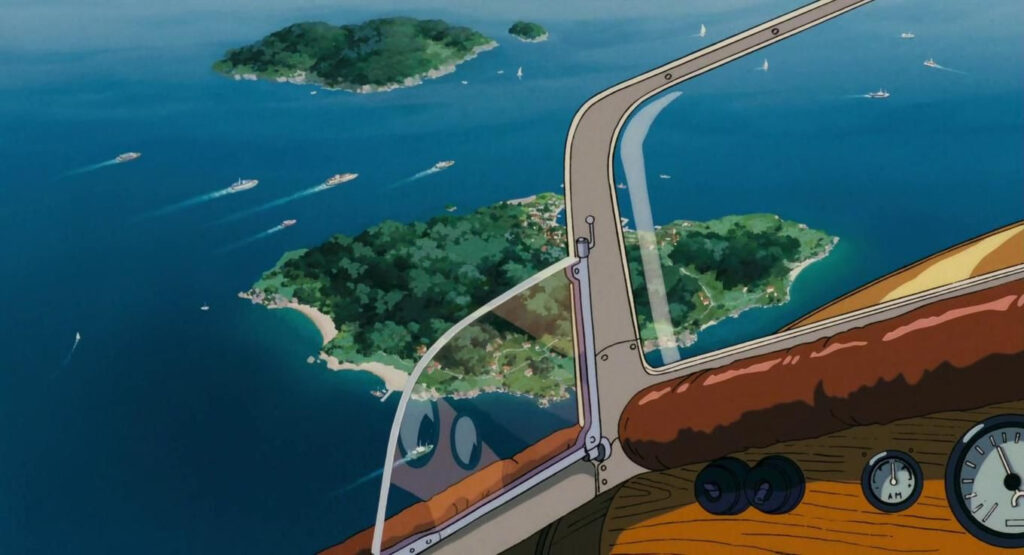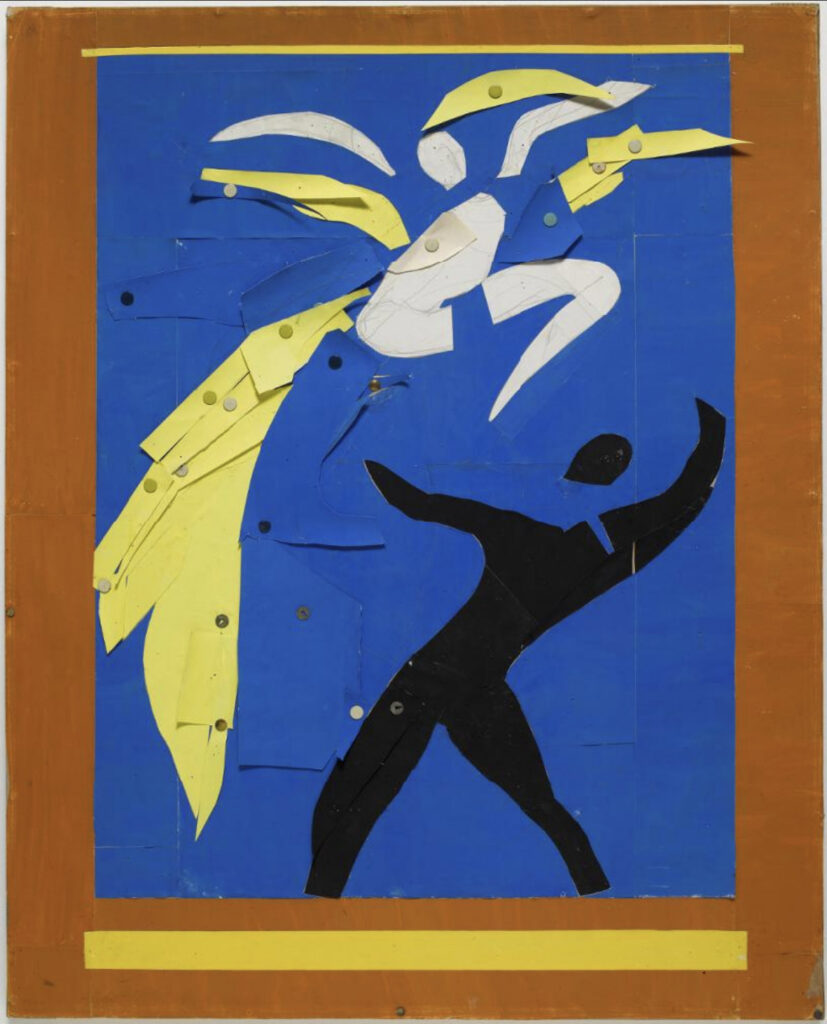Ma sœur m’appelle de Tunis où elle est expatriée. Son excursion dans le désert, les enfants qu’elle a inscrits aux ateliers de mosaïques pendant les vacances, ses copines expats et leurs propre marmaille… Il y a toujours des prénoms nouveaux que je fais semblant de retenir [moi et ma mémoire pourrie]. Et toujours des neuro-atypicités à analyser et discuter – ce soir, autour d’une composition de paysage fleuri, à base de mosaïques.
« Bon voilà, termine-t-elle, pendant que toi tu discours au Sénat, moi j’emmène mes mômes à l’atelier de mosaïques. »
On rit ; sa phrase me fait furtivement penser à des lobsters en papier mâchés, et c’est elle qui continue :
« C’est comme dans Love Actually, tu sais, Emma Thompson et son frère Hugh Grant qui est Premier Ministre. »
The trouble with being the Prime Minister’s sister is, it does put your life into rather harsh perspective. What did my brother do today? He stood up and fought for his country. And what did I do? I made a papier maché lobster head.
— Emma Thompson, en Karen, in Love Actually, dir. Richard Curtis, 2003
Il y a heureusement quelques ordres de grandeur dans les niveaux d’importance et le parallèle est ridiculement disproportionné. Mais la communion de pensées quand on a grandi ensemble, qu’on se comprend, s’émeut et s’analyse avec les méthodes scientifiques et humaines les plus performantes du monde, et qu’on se retrouve même autour de têtes de homard en papier mâché par delà la Méditerranée, c’est ça, être sœurs.