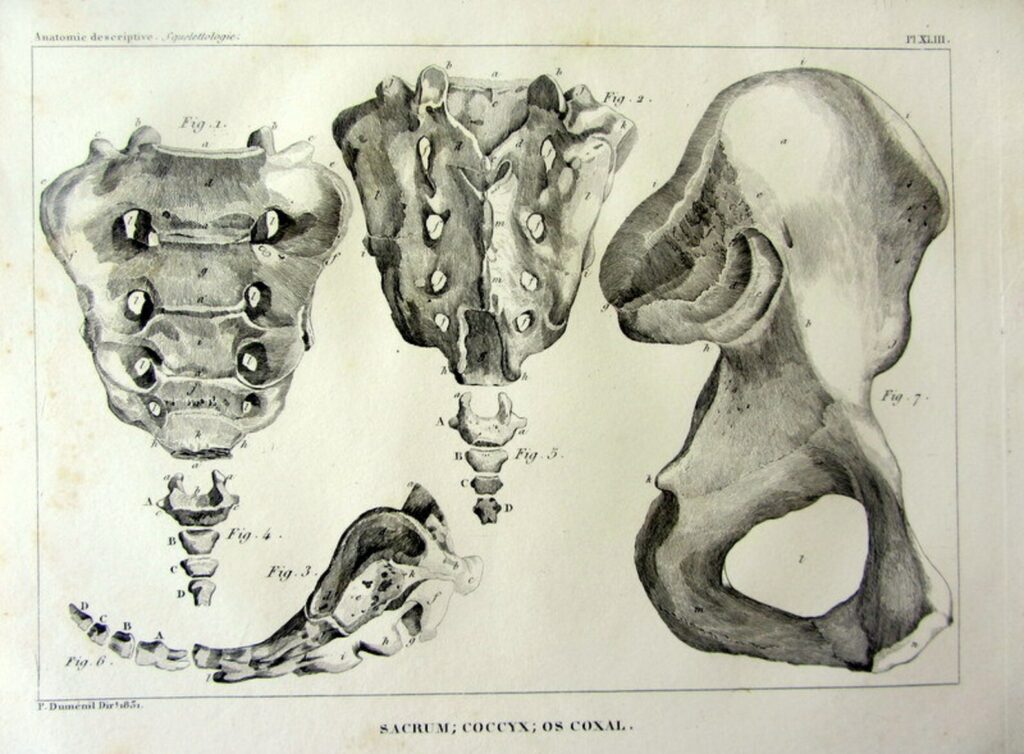Lorsque les sens se noient dans la bouillie cérébrale, heureusement, il reste le squelette bienvenu des mots. Voici en quelques points la dissection d’un état estival post-frénésie. Le feuilleton dégoulinant de l’été.
Il y a celle à la carrure grande et forte qui me raconte comment un ministre l’a appelée « Madame » tout en donnant du « Docteur » à son collègue. L’autre qui m’explique qu’elle avait mis du temps à accepter de bien s’habiller car elle avait peur que les hommes ne la voient plus comme une expérimentatrice. Elle me montre ses talons taupe : « Mais j’ai toujours dans mon bureau une paire de sneakers sales pour aller dans mon lab. » Je déballe à mon tour ce moment mémorable où un chercheur « bienveillant » m’a demandé comment j’allais gérer mon stress, à la présentation de mon projet de direction.
Et puis, dans la chaleur abêtissante, sur les bancs de bois du Plein Air Café, j’écoute longtemps une jeune doctorante aux cheveux longs qui dit : « Je ne comprends pas pourquoi, dès que j’ouvre la bouche, il me fait comprendre que c’est nul, et dès que c’est mon camarade, c’est toujours super. C’est comme ça depuis des mois, je n’en peux plus. »
Plus tard, me faire crier dessus dans les rues sombres du Loop par le directeur de thèse en question, à qui j’expose la chose – avec trop peu de tact et de stratégie. Encaisser, écouter, garder mon calme, et faire tourner mon cerveau très vite pour sortir de ce non-sens émotionnel qu’on m’inflige.
Je crois que c’est tout cela qui m’a terrassée, cette violence et cette solitude infinie – la solitude d’être celle à qui on s’accroche, celle responsable de l’âme de la collaboration G., celle qui doit tenir et être irréprochable dans un monde dur et biaisé.
Son : Clara Ysé, Pyromanes, in Oceano Nox, 2023