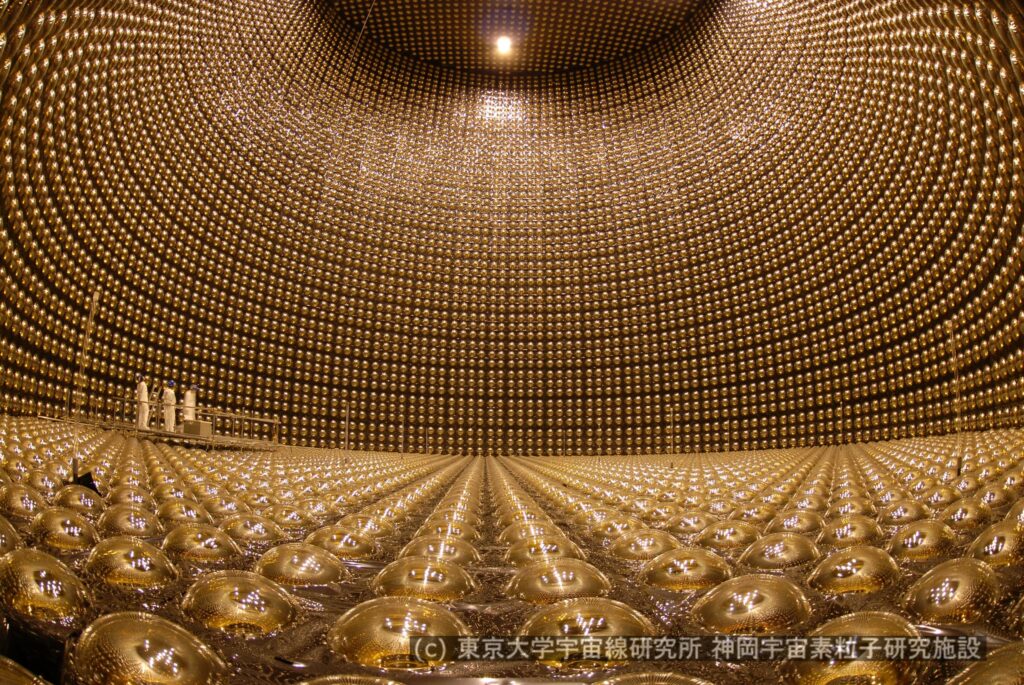Depuis le quai de la Keihin-Tohoku-Line, à l’aéroport, j’écris à O. : « À chaque fois que je reviens ici, je me rappelle pourquoi je n’habiterai jamais ici. »
Mais la vérité, c’est que je suis très heureuse. Dès que j’ai débarqué de l’avion, j’ai senti l’odeur de la bienséance japonaise. Devant le business hotel, l’odeur nocturne caractéristique, suintante de souvenirs, de moteurs, de propreté et de friture, mêlée à la moiteur de l’air.
Sous les cerisiers avec O., dans la pénombre des lanternes rouges, on partage nos bentos et on se raconte les derniers épisodes de nos vies, sans entrer dans le détail – avec O., il suffit toujours d’esquisser quelques faits, quelques émotions saillantes, et on s’aligne sur nos réserves respectives ; je n’ose franchir la ligne qui nous protège, qui nous rend si proches, si connivents, unis et à la fois disjoints. Longuement nous cherchons comment nous sortir du labyrinthe de la collaboration G. dans lequel nous sommes enferrés. Sans vraiment converger.
À l’aube, après une nuit sans sommeil, je vais errer dans Ueno-koen, poser quelques poèmes et mon esprit, j’écoute le concerto pour violon de Barber, et je suis tellement émue de ressentir, comme au printemps dernier [ici et tous les billets suivants], la puissance douce de la différence ici. Longtemps j’ai été étrangère sans l’être au Japon, et cela me frustrait. Maintenant, je suis étrangère sans l’être, je lis toute la différence, et je ne cherche plus à la résoudre. L’acceptation d’être, disions-nous l’autre jour, dans deux conversations indépendantes, avec ma brillante C. et l’élégant M., c’est probablement la seule façon de vivre.
Son : Samuel Barber, quel étrange que son Concerto pour violon, pourtant si américain et si grandiloquent, soit devenu depuis l’année dernière, la musique qui accompagne mon Japon. Interprété par Hilary Hahn, Hugh Wolff, Saint Paul Chamber Orchestra.