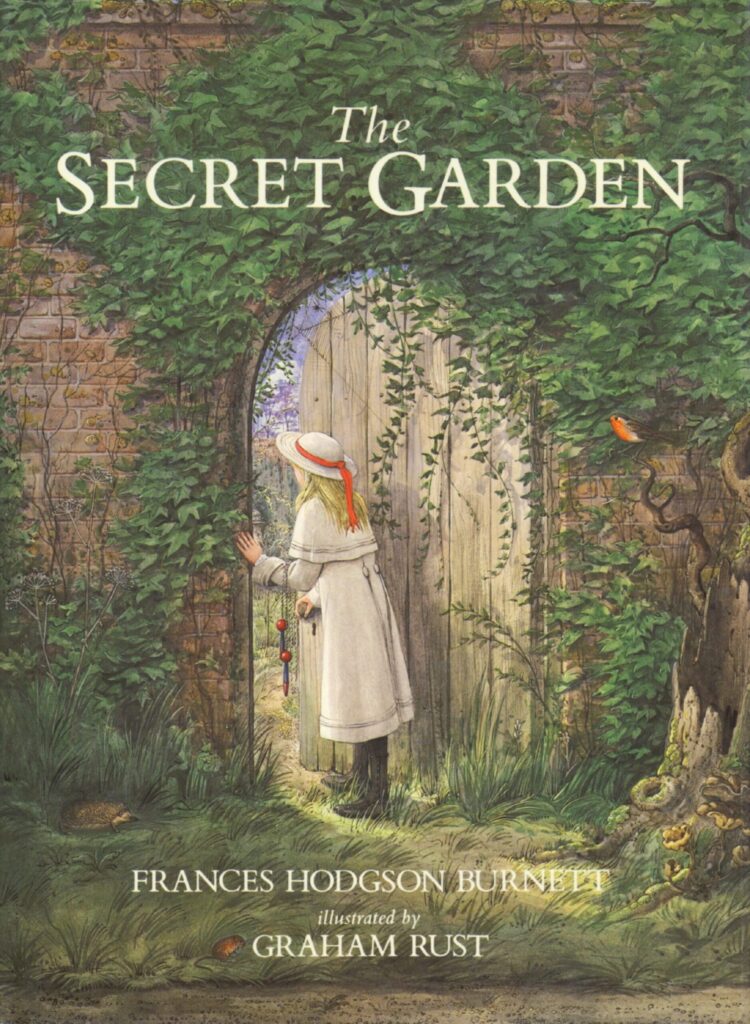Je pianote à la hâte à un ami cher : je suis à cet endroit où il ne faut pas regarder trop loin devant, au risque de tomber ; l’épuisement a creusé les sols et affiné le fil. Je me tâte à aller au concert le soir, mais rater Dieu (Esa-Pekka Salonen) et Benjamin Millepied à la Philharmonie, sous prétexte qu’on est crevé d’avoir fait des camemberts et de l’ANR toute la nuit, c’est ne pas avoir compris grand chose à la vie.
Le concert commence – A. à ma gauche, K. à ma droite — alors que je viens de mettre mon téléphone en mode avion, juste après avoir modifié en urgence, une énième fois, ma candidature ANR.
Et la meilleure chose qui pouvait m’arriver arrive : je me prends une grosse latte de manteau de vieille peau.
Elle est vieille, acariâtre, cheveux filasses, jupe tailleur écossaise rouge pétant. Elle n’est pas contente parce que je ne suis pas assise complètement au fond de mon siège, et pour me le signifier, elle dégaine son manteau et me frappe avec.
Pendant ce temps, Dieu dirige un octuor à vents (Stravinski). La quiétude et la lucidité se déposent en mon sein, un effet presque visuel. Le dernier mouvement de Bartók me roule dans un bruissements ému, et toujours cette quiétude. À l’entracte, je prends les enfants par la main et vais tranquillement signaler l’incident à l’ouvreur. Il m’écoute, prend note, me propose d’aller voir son responsable. Je comptais m’arrêter là, mais le traumatisme que dégagent mes enfants m’incite à faire un peu plus. Histoire de leur montrer qu’on ne laisse pas passer ce genre d’agression, et qu’il est possible d’agir sans monter la voix, sans agresser en retour, et qu’on est soutenu, je vais voir la responsable – qui, au-delà de la condamnation de l’acariâtre, me propose de changer de siège.
On nous conduit dans le parterre et A. étouffe un « Waaa ! » Nous voici installés à côté de Benjamin Millepied, qui absorbe, impassible, sa chorégraphie. (Son absorption devient alors pour moi le premier spectacle.) Dieu non plus n’a jamais été aussi proche, avec son costard fendu dans le dos et sa main droite gantée de rouge, en costume pour diriger Boulez et son Rituel.
Il manquait un fauteuil, alors j’ai pris K. sur mes genoux. Les drames, les vies et morts sont dansés en haillons sur scène – et moi je respire l’odeur de viennoiserie qui se dégage de K., j’ai sur les cuisses sa rondeur et sept ans de joie pesante. Je suis mammifère, du bout du menton posé sur sa tête chaude, aux doigts qui maintiennent la chaleur de son ventre.
Et voilà comment une latte de manteau de vieille peau m’a rapprochée de Dieu et du règne animal.
Son : Béla Bartók, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Musique pour cordes, percussion et célestra, Sz. 106: IV. Allegro molto 1962.