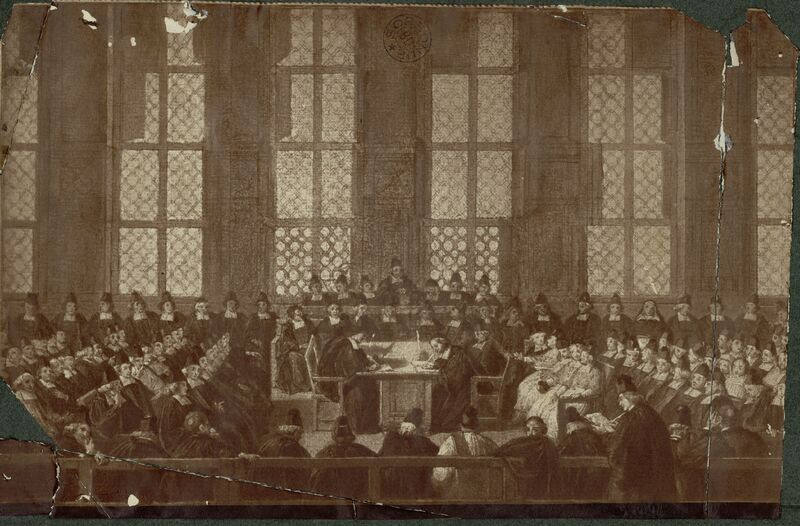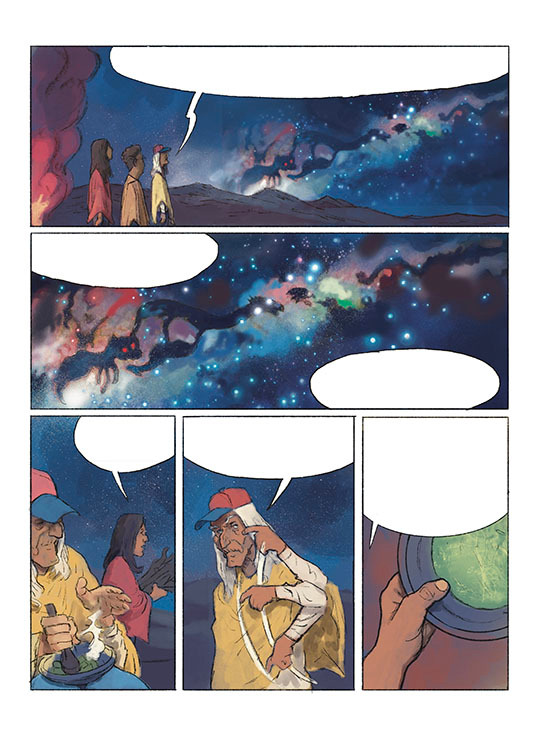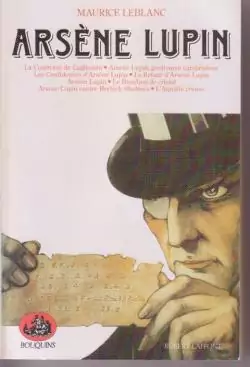Le risque de pondre des billets en série pour vider son cerveau, en se relisant à peine, c’est qu’on quitte l’« exercice d’écriture » et pour tomber dans le journal intime à vomir qui conjugue bisounourserie, autocomplaisance et style lourd… [Je déconseille aux rares lecteurs de ces pages de lire les billets qui précèdent, sauf besoin d’un vomitif.]
Je crois d’ailleurs qu’en écrivant ce livre « de science », j’ai travesti mon écriture – si jamais j’en ai vraiment eue une. J’y ai cassé tout ce qui était elliptique et étrange… pour « ne pas perdre le lecteur » et faire plaisir à mon éditeur. « Tu exagères, » me dirait-il. Et il aurait raison.
Un jour, il faudrait qu’au-delà de bavouiller ici en qualifiant pompeusement la démarche d’« exercice », je me jette un peu plus sérieusement dans la littérature, et que je lise, que je lise.
J’ai l’impression dans ces pages d’être en vase clos, de me répéter, d’alterner entre trois tournures et modes d’expression. En relisant mes anciens billets, je m’auto-alimente. Ce carnet est un ChatGPT vivant.
Note 1 : D’ailleurs, Chat GPT me répond « Votre réflexion soulève des points essentiels sur l’écriture et l’authenticité. Écrire de manière répétitive peut mener à une stagnation et éloigner de sa voix personnelle. Explorer et renouveler son style est crucial. L’idée de plonger dans la littérature est inspirante et pourrait enrichir votre écriture. Le parallèle avec un « ChatGPT vivant » souligne le risque de schémas prévisibles. »
Note 2 : Le titre de ce billet a été proposé par ChatGPT. Voilà.