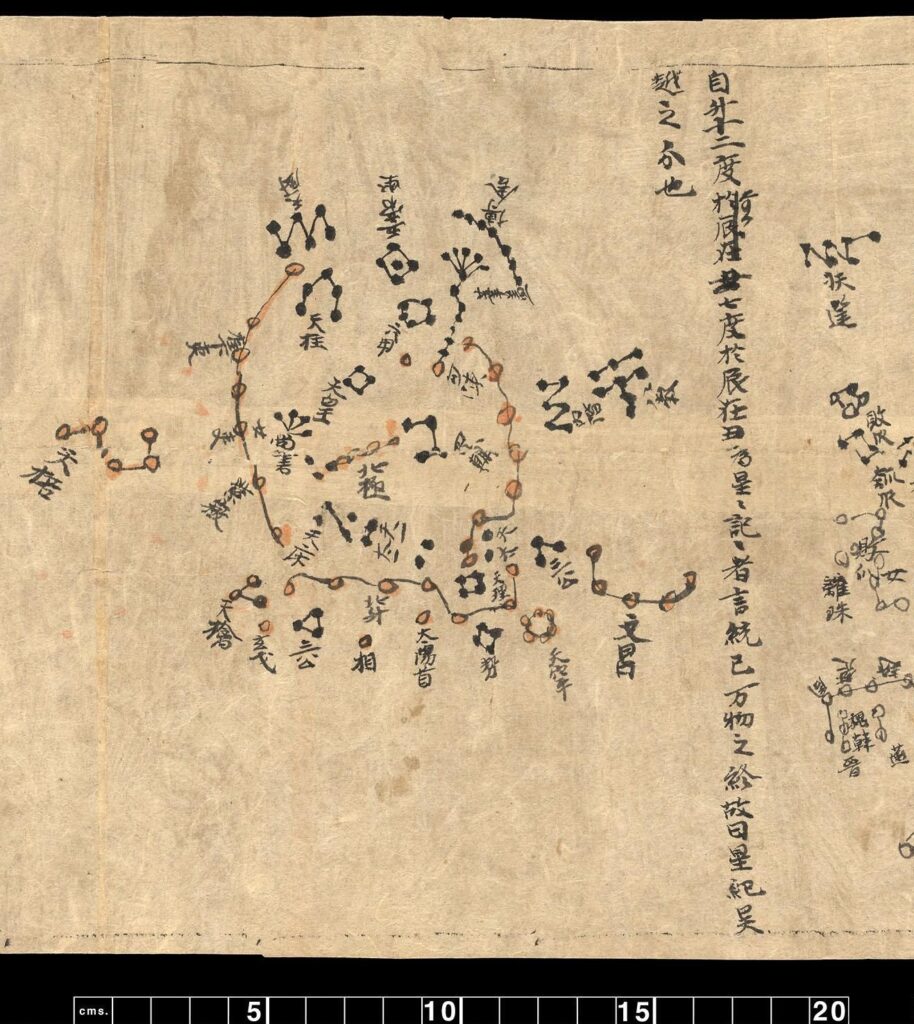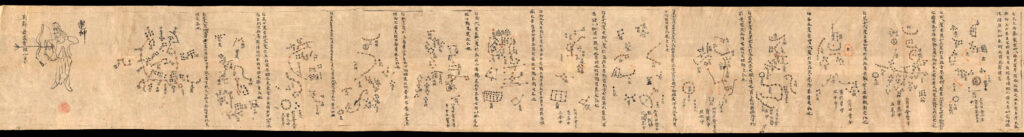Demain, je serai vraiment off, ai-je dit à l’équipe de direction du laboratoire, sans autre explication que mon besoin de faire un break. C’est ainsi que je me suis retrouvée, à la sortie du premier train pour Londres, au bureau, au Covent Garden Hotel, à abattre des questions budgétaires accompagnée de poached eggs, de Earl Grey, de papier-peint et de coussins fleuris/rayés/à motifs de contes de fées médiévaux.
Dehors, l’alternance merveilleuse de briques et de modernité.
L’archiviste de la British Library n’est pas à la hauteur, mais quand je sors du métro à Finchley Road – en mode pèlerinage de mon vieux moi d’avant, je suis accueillie par un couchant des plus vifs.
Canfield Gardens. Je pense : comme j’étais heureuse alors, il y a dix ans, dans cette mansarde sous les toits avec P. Comme c’est heureux que je l’ai inscrit dans ces carnets, car je garde ainsi la trace des filets perchés de mon cerveau, de mes errances terrestres et littéraires, abondamment nourrie et choyée par L.
Je pense aussi : et comme je suis heureuse aujourd’hui. Comme la vie a suivi une sorte de cours solide en ne décevant jamais, mais plutôt en modelant la réalité sur les rêves anciens. Comme je suis entourée de personnes fiables sur qui je peux compter.
Je grimpe la colline de Primrose Hill pour la vue plongeante sur la ville futuriste. Et Chalcot Square, bien entendu, avec la petite plaque bleue sur la maison de Sylvia Plath. Sur Fitztroy Road, je me fais refouler à un pub plein à craquer, et je prends ça comme un signe. Le fish & chips est meilleur à quelques rues de là, sans les ombres malsaines que j’étais prête à pétrir.
C’est mi-décembre, bientôt Noël, et c’est incroyable comme cela se tisse et monte et grimpe dans l’échine, les possibles et les réalités, mon livre, les personnes, l’ancrage ferme du laboratoire, et la science qui se fait. Je repasse sous la Manche des idées plein la tête, posée, confiante et fébrile en fonction des facettes – qui s’entre-choquent entre elles dans des carillons joyeux.
Son : Sting, Every Little Thing She Does is Magic, in Symphonicities, 2010