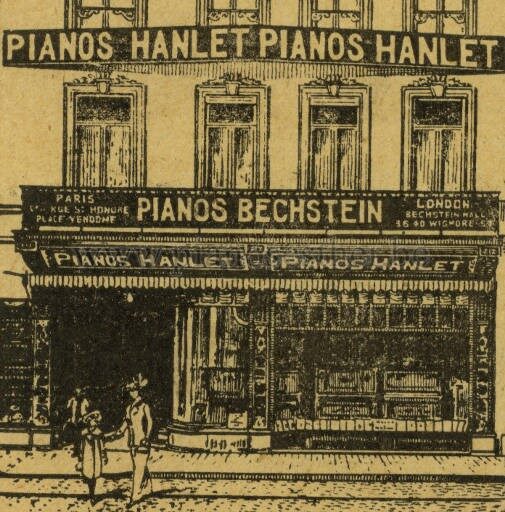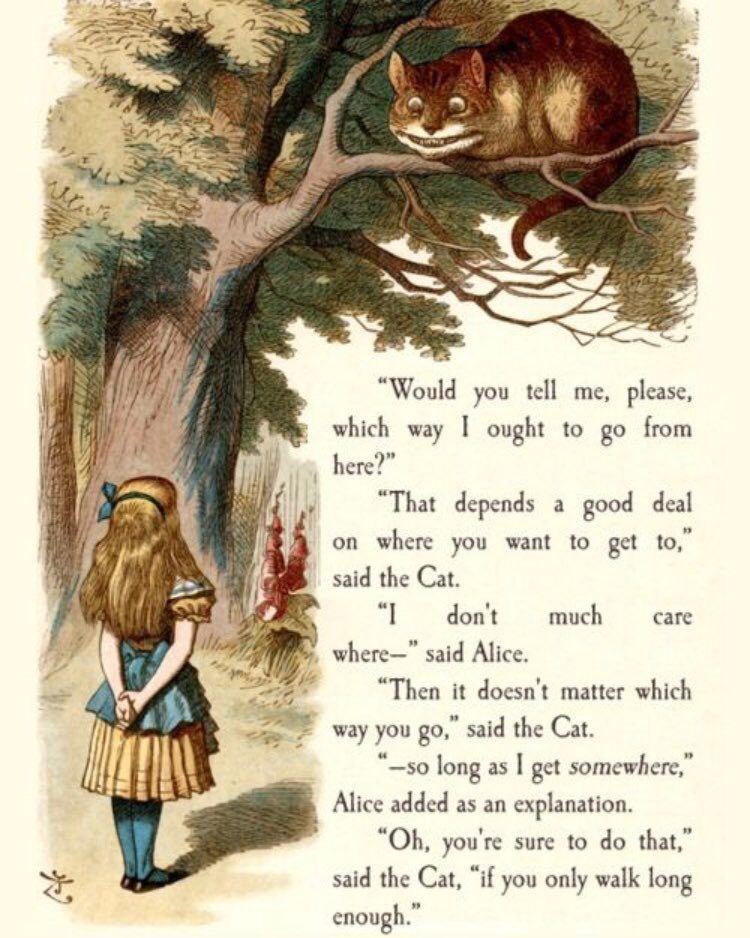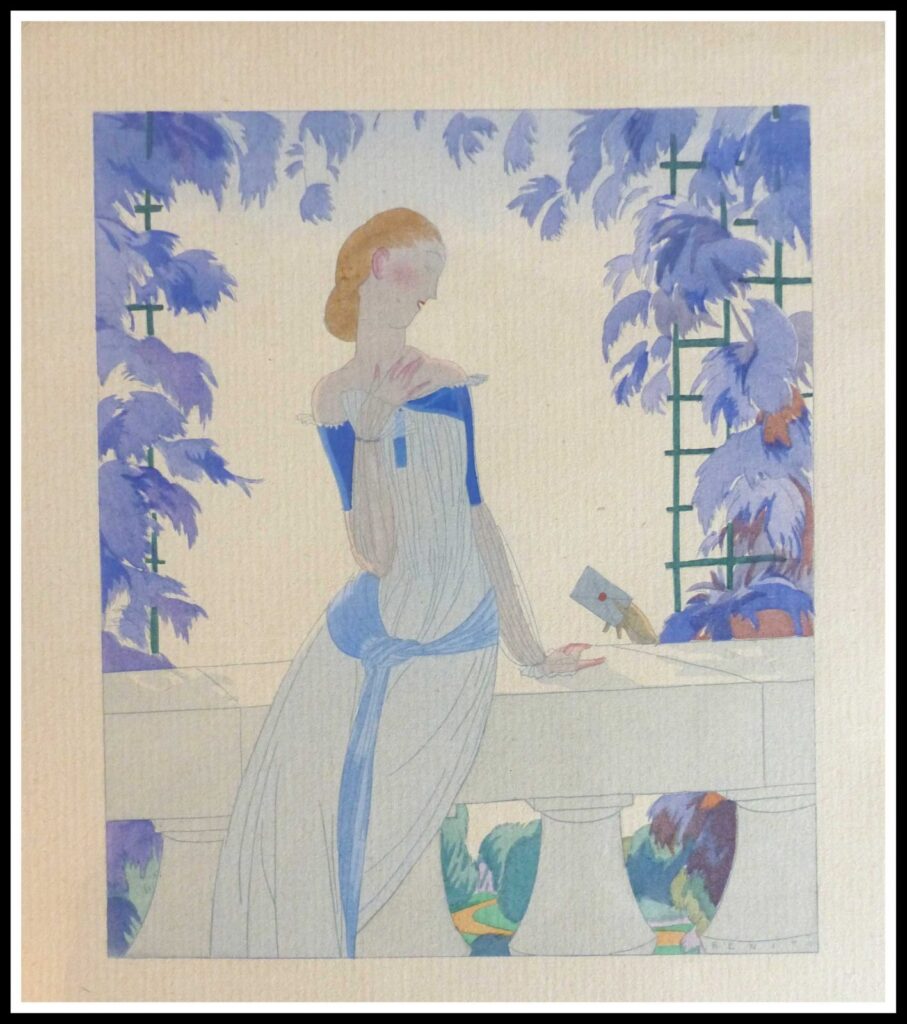Son : Je découvre Grand Corps Malade – comme pour Taylor Swift, lorsque je débusque la poésie derrière les préjugés de succès populaire, c’est étonnant et rassurant de savoir que la foule s’émeut de jolis mots et les acclame. Grand Corps Malade, Mesdames, 2021. À défaut de la limpidité touchante des enfants, la voix profonde de Fabien Marsaud. Impossible d’appréhender ce billet sans cette écoute.
Le concert est terminé, on a applaudi, mais ils installent deux micros des deux côtés de la scène noire, les enfants de CM2 se rangent en file derrière, et sur un piano-voix, chacun quelques vers, tour à tour ils se placent au micro et ils slamment
Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration
Comme une tentative honnête de réparation
Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures
Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture
Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes
Que la gent masculine qui parle fort, prend toute la placeDerrière chaque homme important se cache une femme qui l’inspire
Derrière chaque grand être humain pressé d’une mère qui respire
— Quentin Mosimann / Fabien Marsaud / Thierry Leteurtre,
paroles de Mesdames, de Grand Corps Malade
leur voix claire d’enfant de dix ans, tendue vers une adolescence montante, dans quelques mois ils seront au collège, les gamines que j’ai vu pleurer hier encore pour leur doudou, dans leurs pantalons larges, grandes, cheveux lissés, regard sérieux et bouche ronde ; et les garçons mal dégrossis tout aussi sérieux, habillés un peu court, grosses lunettes et bras ballants
La pureté
toute suspendue dans leur diction – et ce texte, une claque
21h dans le théâtre de la ville de banlieue, nous nous attendions tous à un spectacle de gamins restituant en chœur un travail de quelques mois, une chorale de primaire
Moi c’est pour ces moments-là que je vis. La surprise quand elle vous prend, vous vous rendiez à une chose banale et soudain on vous arrache, et vous enfoncez les ongles dans vos paumes pour arrêter l’eau et le rouge qui vous consume. Pour ces moments où ensemble, parents de tous horizons, on s’est arrêté de respirer, on s’est isolé quelque part entre l’émotion, votre enfant qui exhale des mots, les spots d’or qui illuminent les deux rondes déclaratives de filles et de garçons, une poignée tout autour de chaque micro, ils répètent
Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices.
Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis.
Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs.
Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme.
La déclaration, comme toutes les autres qui dans l’ombre portent les doigts à la commissure des yeux, je la prends en plein cœur. Je réponds à ces dix enfants, à mon fils, je n’ai pas peur de la candeur, je réponds que oui. J’accepte. Merci.