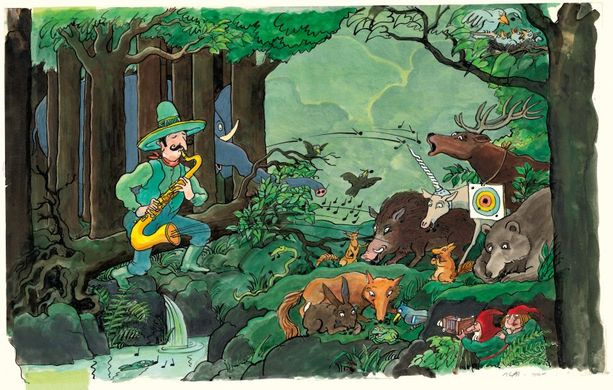Yo-Yo Ma et Kathy Stott.
Menino de Sergio Assad dans son arrangement violoncelle – piano
et le Cantique de Nadia Boulanger
Il dit en français [Yo-Yo Ma est né à Paris et y a vécu jusqu’à ses sept ans] : je dédie ce concert à la collaboration, et à la musique qui se construit sur les épaules des géants, la passation… Ils jouent Fauré, qui a enseigné à Nadia Boulanger, qui a enseigné à Kathy Stott.
C’est leur dernier concert ensemble, et ils ont choisi avec soin, dit-il, des morceaux qui évoquaient des moments forts.
Menino, délicat ciselage de nostalgie et de folklore ; Sergio, je l’imagine les yeux clos devant le lac Michigan à perte de vue, assis, vide, sur sa chaise. Puis le moment où, une guitare entre les bras, dans cette posture courbe et tendre, il se mue en musique.
Je transmets le message de Yo-Yo Ma à Andromeda, qui me répond Wow, Sergio est très touché.
Et ainsi, depuis ma place au 2ème balcon, à côté de l’oreille toujours appréciative de A., ce bout de fil insolite tendu de la Philharmonie de Paris à l’autre bout du monde, d’auditrice et interprète au compositeur ; de création à envolées et réception.
Sons : Sergio Assad, Yo-Yo Ma, Menino, in Obrigado Brazil, 2003
Nadia Boulanger, Yo-Yo Ma, Kathryn Stott, Cantique, in Merci, 2024