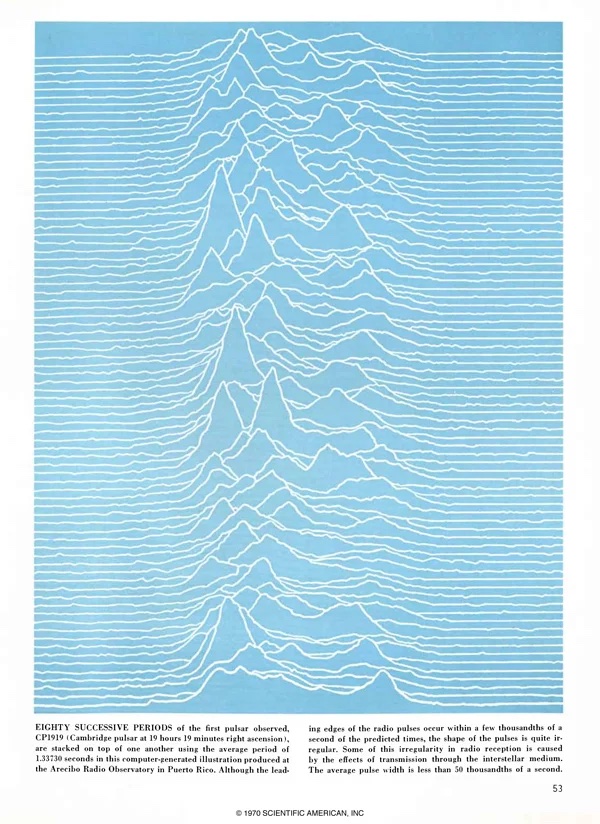Le brouillard a pris toute la ville, j’entraîne ma petite foule au café dans Printers Row où nous avons fait nos premiers pas chicagoans perchés dans le loft d’Andromeda. Puis nous filons au nord où je voulais retourner voir les lionceaux, l’apaisement de leur respiration, leur poils hirsutes qui se soulèvent dans le souffle de la vie – je dis à P. : j’aimerais avoir mon bureau au-dessus d’un rocher de lions, pour la grâce reposante de leur slow motion. À midi, je propose : retournons manger des ribs au Miller’s Pub ! Le bus nous ramène vers le Loop dans les odeurs de silex et d’orange qui émanent de mon sac à main. Entre Michigan et Wabash, je m’engouffre par hasard dans la porte arrière du Chicago Symphony Orchestra, qui me faisait signe. Des étudiants du CSO habillés en tenue renaissance entonnent des Christmas Carols dans le hall. La foule se hâte avec des billets, alors j’avise un guichet et demande ce qui se joue. Nous n’avons pas encore déjeuné, notre vol est dans quatre heures, je soupire parce que la liberté est perdue avec les enfants, prête à me faire une raison… Mais A. s’interpose dans ma déception « Moi je n’ai pas besoin de manger maintenant ! Allons-y ! » Nos deux folies résonnantes ont raison de l’inertie des deux autres, et nous voici installés tout en haut de la grande salle enguirlandée du CSO, avec des chocolats ruineux à déguster en cachette pour couper la faim. Programme musical de Noël sans prétention et tellement américain, ils ne nous jouent pas Casse Noisette, mais Orpheus d’Offenbach, donc c’est tout comme…
Mais c’est comme ça que ça doit être, n’est-ce pas, la vie ? Entrer dans des portes au hasard des rues, et se retrouver dans la musique et les lumières, chanter Joy to the World accompagnés du CSO, écouter Ashley Brown parodier All I Want For Christmas pendant que K. colle sa joue contre la mienne et peigne mes cheveux de ses petits doigts. Les dégoulinades de beaux sentiments énoncés par le chef d’orchestre, qui atteignent le cœur parce que nous ne sommes pas en France. L’Amérique c’est cela aussi : la simplicité des émotions et des volontés manichéennes. En cette période de fêtes, cela me sied parfaitement. Dans la semi-obscurité dorée, je lance un regard complice à P. –qu’il me retourne : je serai toujours là pour prendre ces portes dérobées et chercher à nous plonger dans la magie, et je te remercie de me faire confiance et de m’y suivre.
Son : Leroy Anderson, BBC Concert Orchestra, Leonard Slatkin, Sleigh Ride, 2008.