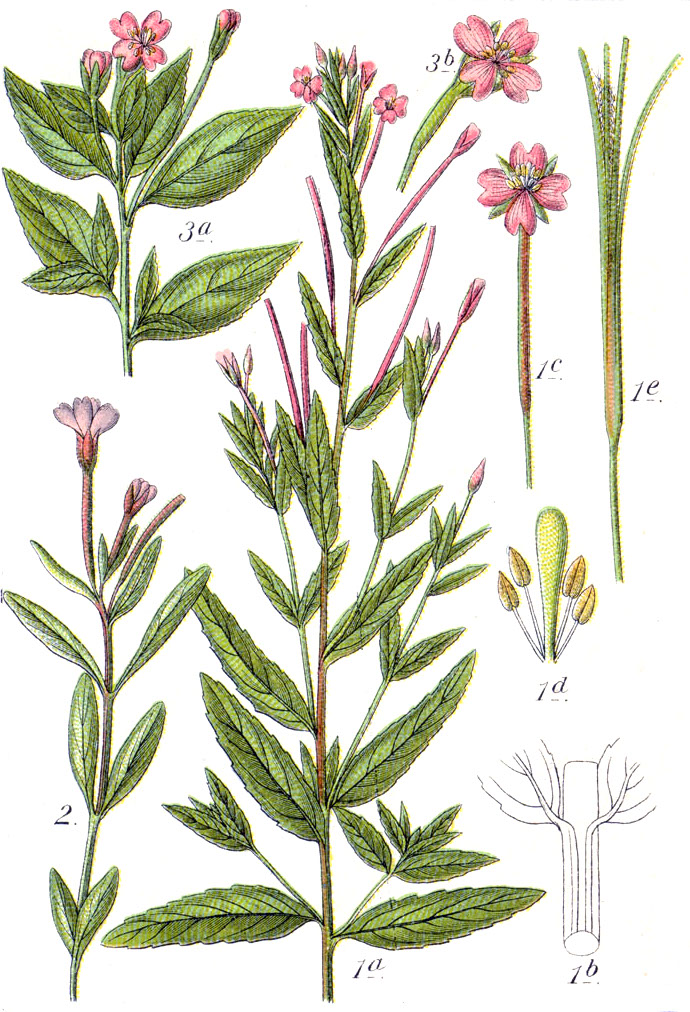Plongeon dans des dossiers oubliés de mon ordinateur, dans des textes d’il y a tout juste vingt ans. Mon moi jeune, étudiante, idiote, seule, incertaine, converse avec un personnage imaginaire.
Parmi les thèmes récurrents : la crainte de ne jamais rencontrer personne pour vivre en couple, car imbuvable au quotidien, et à cause de cette disjointure irréconciliable entre mon monde éthéré poétique et la réalité crue. L’amertume de ne jamais pouvoir devenir astrophysicienne car pas assez douée. Les envies non assouvies de parcourir le monde. L’anxiété de cette page blanche du futur.
Et malgré tout, une telle soif de vivre la vie jusqu’à la fibre, et une volonté viscérale d’aller de l’avant. Une foi fantasque en ma plume, en sa capacité à donner corps à mes rêves.
J’ai une gratitude infinie – pour ces personnes qui m’ont accompagnée, soutenue, nourrie dans ces errances étudiantes, et que vingt ans après je connais et reconnais encore, dans toute leur grâce et les vibrations partagées.
J’ai une gratitude schizophrène, blâmable de prétention et autres inélégances – pour cette gamine de vingt-et-un an qui y a tant cru, à travers les belles rencontres et aventures, mais aussi les larmes, les psychodrames, les incompréhensions et la grande solitude. Contente de la connaître, la reconnaître encore et pouvoir lui dire : « Regarde, gamine, ça a marché. »
Bande originale : Keith Jarrett, I’m Through With Love, in The Melody At Night With You, 1999