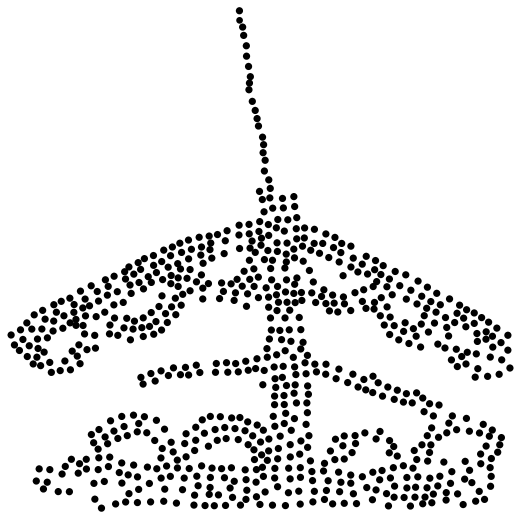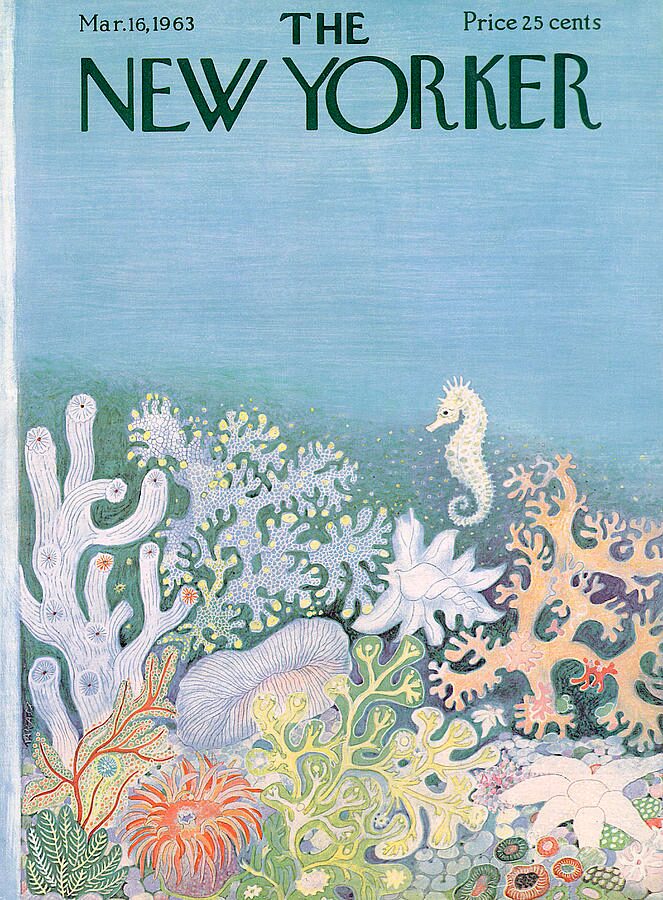Je n’ai pas dit – quand on m’a demandé ce que représente ce morceau pour moi, sur une radio nationale, en direct. Qu’une année entière, j’ai vécu de ne pas comprendre. Pourquoi la beauté était à portée de main mais elle ne l’était pas. Que j’ai pris la rencontre, l’être, nos êtres, les notes de piano qu’on m’envoyait dans des paquets en papier kraft, j’ai tout mis, déversé dans la plus grande crise existentielle de ma vie. Que j’ai cherché en moi un moyen d’exister, de sublimer tout ce que nous n’étions pas, nourrie de ces touches-là au milieu du silence. Que j’ai donné un sens à toute mon écriture, à ma science, à cet Univers violent, avec en filigrane cette douleur-là. L’été humide de Pennsylvanie, les porches en bois et les lucioles au cœur brisé, l’errance dans les allées du campus aux cadavres de cigales vertes, j’ai été si seule – et c’était merveilleux. Merveilleux, tu sais, toi qui ne me liras pas, parce que, au terme de toute cette errance, j’ai sorti ce livre-là, j’ai pris, j’ai tout pris de cette musique et de ces silences, et je l’ai porté là où je le souhaitais.
Au moment où Carrousel passe en direct, ensuite lorsque je traverse ce pont, dans la lumière déclinante, bien accompagnée, cette ballade trouve sa clôture. Nous nous sommes rencontrés pour cette raison-là : pour les dépôts rares et précieux de songes, dans une ellipse tellement infinie, qu’elle m’a permis de cristalliser autour et d’écrire ce livre. Merci.
Son : T. D. tous droits réservés, Carrousel, 2023