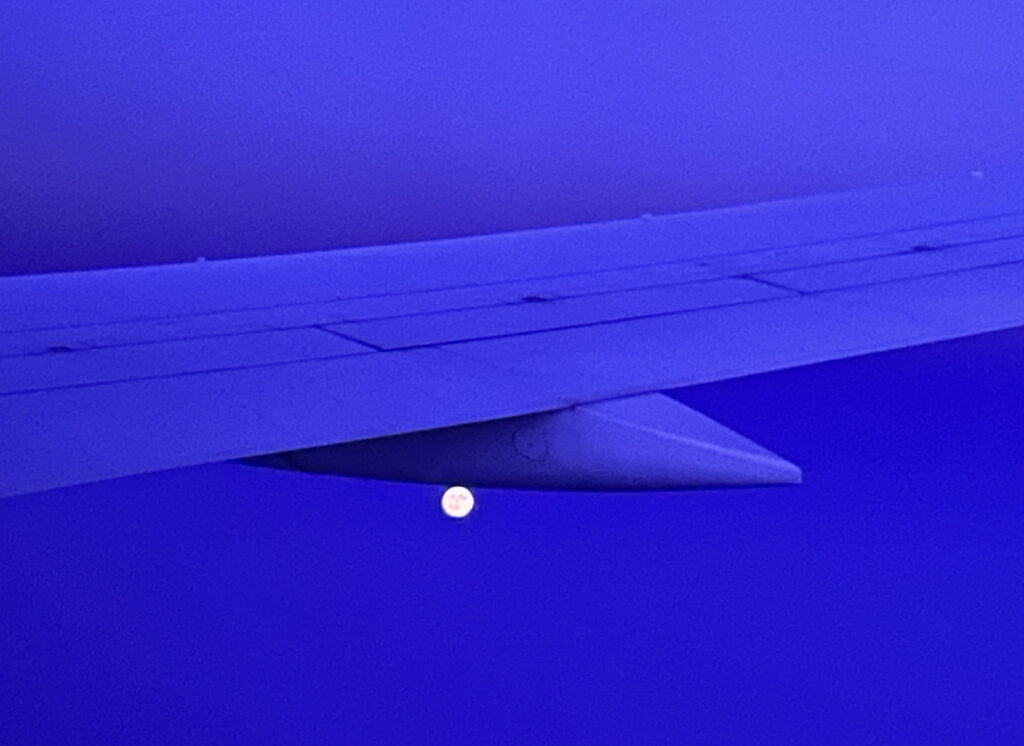K. déguste son foie de veau aux cidre comme si elle allait s’évanouir de béatitude. Quand je lui demande s’il y a des bas dans sa thèse : « Ah oui, les fameux bas… je ne les ai jamais vus, je dois être un peu idiote, je m’amuse tellement ! »
M. au matin, dans mon café hipster, quand je lui demande comment elle se sent en ce moment : « Mais super, ça se passe super bien, je m’éclate dans ce que je fais. »
J., qui vient de commencer il y a trois semaines, assis à côté de moi avec sa planche de jambon de parme : « Bah franchement, je t’avoue, je ne pensais pas que j’allais prendre autant mon pied dans ma thèse ! Je suis trop content ! »
Et les autres nouveaux venus, et C, V, S, F toujours magnifiques, les chercheurs et ingénieurs sur lesquels on peut compter, cette équipe pleine d’entrain, que j’entraîne dans mes cafés, mes restaurants, les résultats qui se construisent avec leur brio et l’intensité complémentaire de leurs esprits, les sujets qui se répondent que nous avons choisis avec O. et R..
J’aime que nous soyons cette effervescence. Le domaine s’y prête. La phase de l’expérience s’y prête. Vous êtes ceux qui posez les premières vraies pierres de G.. Bientôt, je suis sûre, nous irons fêter la détection avec nos antennes des premiers rayons cosmiques.