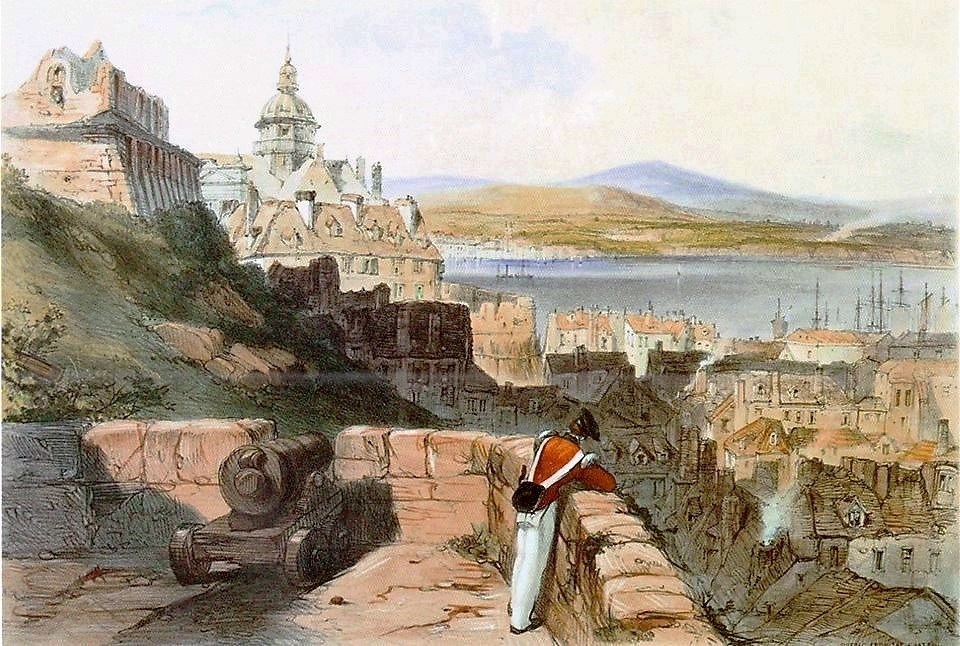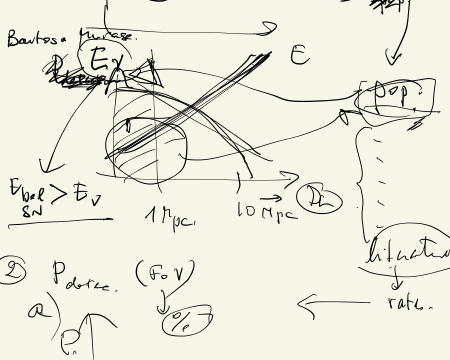Assommante chaleur humide et collines appalachiennes éclatantes d’été vert sombre.
Nous cueillons des pêches bien mûres dans les vergers, et j’en mets plein mon chemisier.
Dans leurs chambres, les enfants jouent au restaurant, à l’école japonaise, Villa Lobos au piano.
Je me réfugie dans mes cafés climatisés, je réponds à des mails, je me dis qu’il faut relire et corriger mon livre. Qu’il faut que je fasse des figures pour l’article que je veux écrire. Je reçois des mots délectables d’un lecteur assidu de ces pages, qui donnent tant de sens à ces inepties dégoulinantes.
Des heures durant, je bavarde avec ma sœur, puis avec X., coincé dans un aéroport. Nous parlons bipolarité, natures humaines, EMDR, et de clubs libertins luxueux dans des caves à Paris. J’aime chez lui la pertinence de ses analyses, sa rationalité – sur lesquelles nous nous rejoignons – et malgré tout la sensibilité et le respect des humanités. Avec simplicité et sourire apaisé, il me conte les alentours du suicide de son ex-femme, les séances qui l’ont défait magiquement de sa culpabilité. C’était aussi d’une certaine façon l’objet de notre conversation avec ma sœur, pour qui les horizons s’ouvrent dans des traits sereins et colorés, malgré les innombrables complexités et difficultés inhérentes à la vie : l’optimisme, le positivisme, prendre et mettre en valeur la partie qui sourit.
Au réveil, j’écris à O. : « Merde, j’ai rêvé de toi. Le cauchemar ! » suivi d’un petit échange entremêlé de taf, de cœurs et de gentilles joutes.
L’été – encore quasiment deux mois de cette suavité, la force tranquille des moments partagés, de science, d’écriture, de fruits juteux et de mouvements dans les airs. Je veux rester dans ma bulle, je ne milite pas, je ne me laisse pas pénétrer des anxiétés du monde en chaos politique et sociétal.
Son : Yo-Yo Ma, Marc O’Connor, Edgar Meyer, Appalachia Waltz, 1996