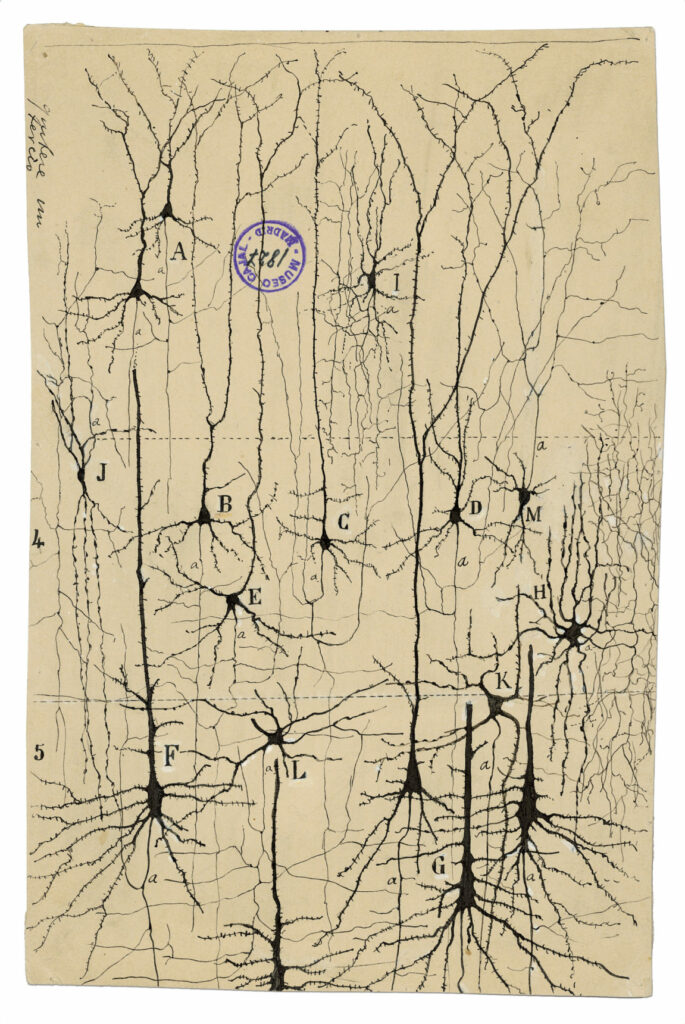Je rentre dans les rues gelées, je suis épuisée, comme si l’épuisement des autres finissait par m’écraser, épuisée physiquement, mentalement, je cherche à m’accrocher à ce qui a du sens : ces colonnes de densité, les processus de perte d’énergie, les termes sources que j’ai griffonnés sur un papier dont il faudrait calculer l’intégrale. Je me sens très rouillée dans la physique mais ce fil-là est salvateur. Je suis au milieu du naufrage familial, des mails de l’école encore, dans des complexités et tristesses ambiantes. Je suis prête à me laisser couler, à arrêter de surnager, laisser filer la lumière. J’écoute le Requiem de Fauré du début à la fin – c’est si pur mais ça n’aide pas.
Et soudain, ce message qui surgit comme un sursaut gamma : « Quel feu d’artifice cette avalanche de billets sur ton carnet aujourd’hui ! J’espère que tes autres lecteurs apprécient autant que moi l’éblouissement que créent toutes ces touches de couleurs illustrant ton chemin dans la vie. Merci ! »
De quoi me figer au milieu de la rue gelée. Gelée. Mais si brûlante de l’intérieur. Je ne sais pas s’il est même possible d’expliquer l’effet que fait un tel regard, une telle lecture et un tel retour sur mes textes. C’est comme si, dans ce partage et cette résonance, en cet instant-là, mon existence prenait tout son sens. Comme si je pouvais maintenant mourir car mon but était atteint. J’aurai écrit et j’aurai été lue. Que demander de plus ? L’ai-je seulement mérité ? Non. Et pourtant je suis là, alors il faut faire, être, écrire encore mieux. Continuer à vivre et à aller vers les lumières. Je ne me trompe pas de direction, je crois.
Son : Le leitmotiv de la journée, impossible de s’en lasser, toujours la même grâce avec Gabriel Fauré, Requiem, Op. 48 : VII In Paradisum, 1890, Paavo Järvi, Orchestre de Paris (2011).