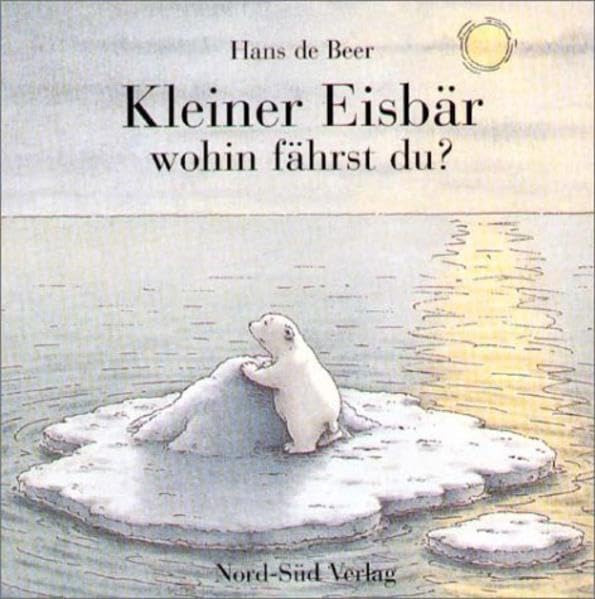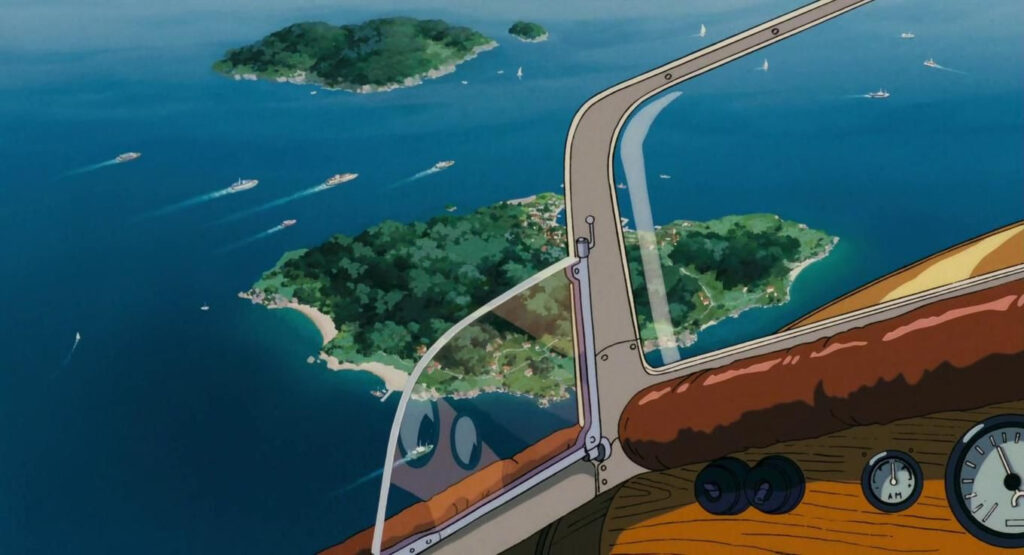Et finalement je vois les grottes de Mogao. Un peu trop rapidement à cause de l’imminence de mon vol, mais dans les conditions idéales d’un site quasi vide, en basse saison.
Grotte 17, cette salle minuscule cachée dans le mur d’une grande chapelle, c’est là que les manuscrits de Dunhuang ont été trouvés, dont la première carte céleste connue de l’Humanité. Une salle l’air de rien, peinte de verdure, la statue de l’érudit assis au centre, une sorte de brique poreuse tapissant le sol. C’est là que Paul Pelliot et Aurel Stein se sont assis avec leurs bougies en 1907 pour faire leur sélection de rouleaux à acheter (à prix ridicule).
Je n’arrive pas à comprendre, l’émotion et le silence qui s’entre-choquent dans ma tête, là où bruissent trop de dates limites et de tâches urgentes, et le manque de sommeil.
Je circule en électron libre parmi les bouddhas gigantesques et millénaires, la profusion de couleurs dans des centaines de salles obscures – je peine à saisir la démence et le trésor. Il me semble que c’est incongru, ces trous dans les falaises (horriblement défigurés pour les touristes d’ailleurs) peints et sculptés sur des centaines de mètres au milieu du désert. Dehors, le silence et le jaune métallique des feuilles sur la rivière, l’implacable bleu pâlissant des déserts et le sec du sable dans l’air.
Je m’assoupis dans la navette qui me ramène au centre, dans les dix minutes de taxi jusqu’à l’aéroport, les vertiges s’accumulent dans les vertiges, de temps, d’espaces et de cultures. À Xi’an, je remercie Pf, qui me tend un gros paquet de billets chinois – le remboursement de mon vol.
Je cherche un café, je m’arrête au Duty Free humer un parfum, et je ne perds pas plus de temps, parce qu’il faut encore de nombreux items à compléter pour soumettre notre ERC – et construire la suite du détecteur, à la chasse aux messagers du ciel violent de Dunhuang.