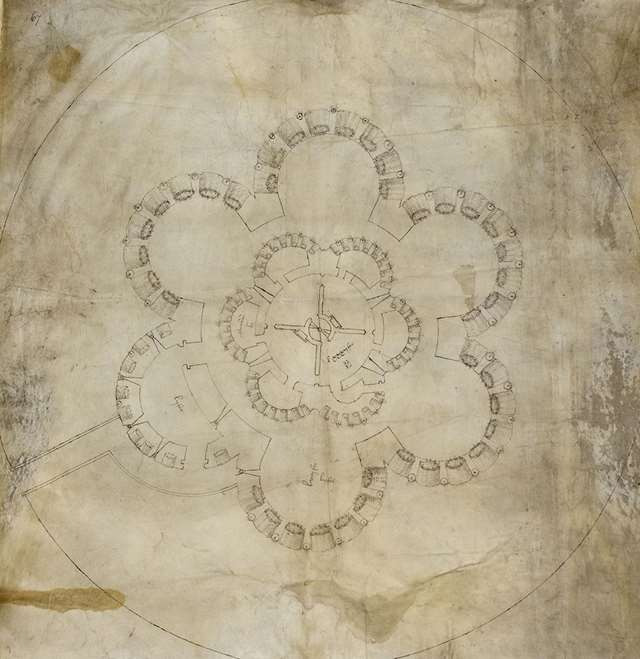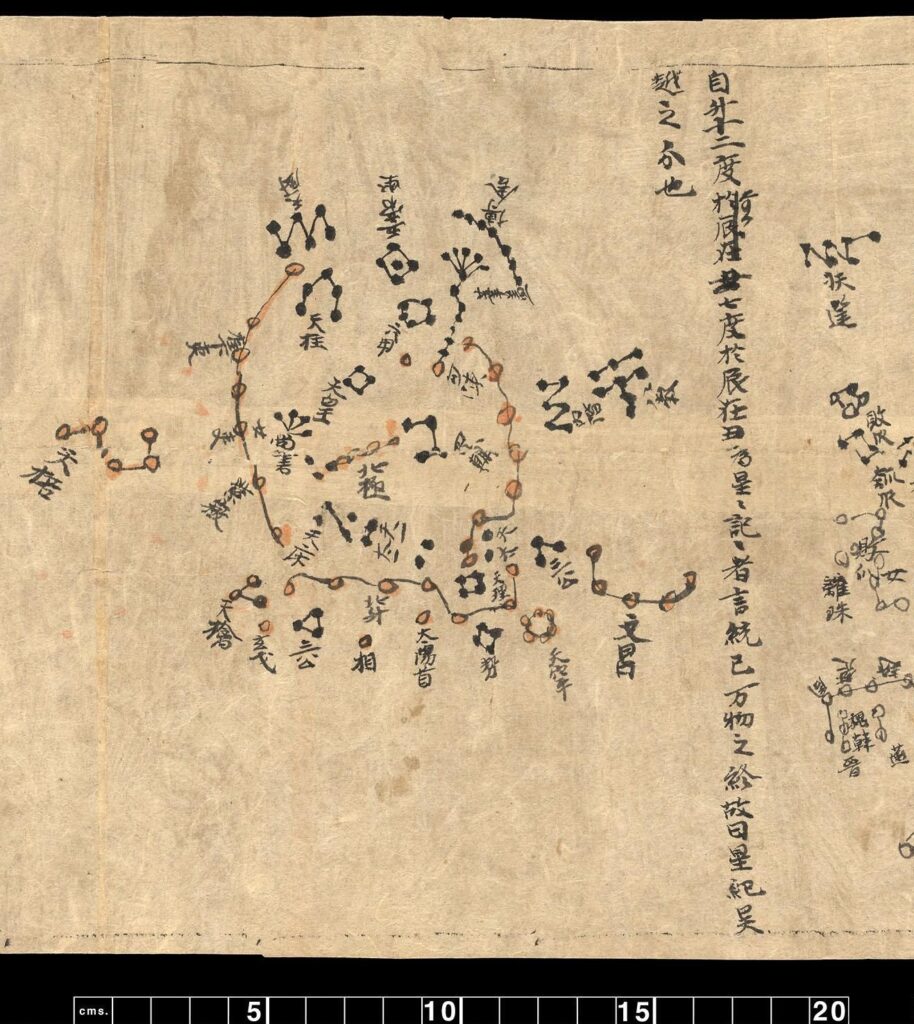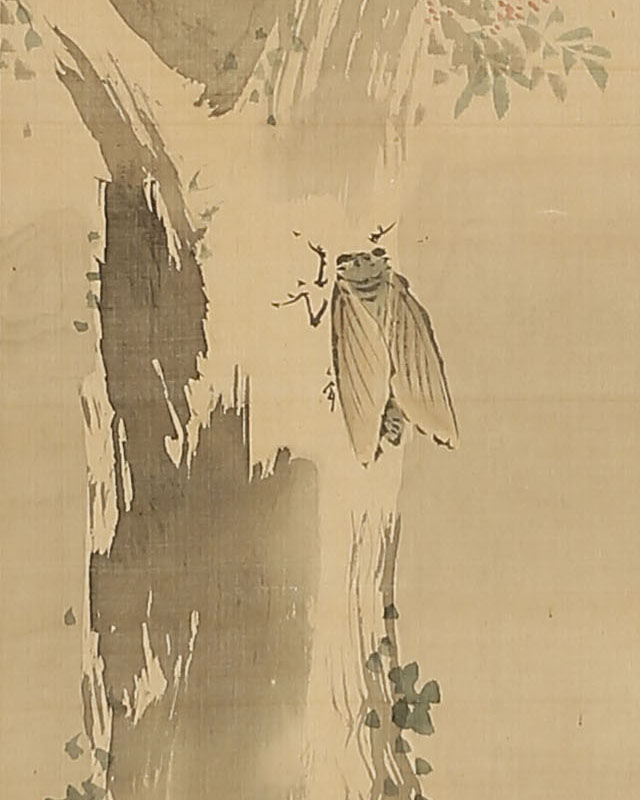Au réveil, c’est comme si je sortais de deux jours alitée à quarante de fièvre et que j’allais pouvoir enfin courir le monde. Ces humeurs calquées sur des facteurs relativistes, c’est peut-être après tout une marque de physicienne tarée.
Les villes et villages anglais, intacts dans leurs colombages et leurs ruelles de sorciers, aux enfilades de charities arborant des porcelaines bleues et roses, tout est à l’heure moderne et en même temps trempé dans son antiquité.
En cherchant le lien entre Thomas More et Canterbury, je découvre que sa tête coupée par Henry VIII est conservée comme relique à l’église St Dunstan. À seize heures, la lumière entre à peine des vitraux qui surplombent la dalle scellant la crypte.
More: If we lived in a State where virtue was profitable, common sense would make us good, and greed would make us saintly. And we’d live like animals or angels in the happy land that needs no heroes. But since in fact we see that avarice, anger, envy, pride, sloth, lust and stupidity commonly profit far beyond humility, chastity, fortitude, justice and thought, and have to choose, to be human at all… why then perhaps we must stand fast a little –even at the risk of being heroes.
— Robert Bolt, A Man For All Seasons, 1960
Coup de cœur de jeunesse pour cette pièce – toujours au lycée. Pour l’oral du Cambridge Proficiency, j’avais disserté sur l’œuvre avec mon emphase de gamine romantique [mon éditeur me dirait, ma pauvre tu ne t’en es pas encore débarrassée].
« I find the character of Thomas More quite shattering. »
L’examinatrice s’était arrêtée, m’avait dévisagée, et je me demande à ce jour encore quelle était sa surprise.
« Why?
— Well, because he was ready to die for his principles. »
Au-delà de mon analyse inepte d’adolescente, le personnage forgé par Bolt est bouleversant dans un mélange bien plus complexe. D’abord sa façon tendre et moderne d’être père/époux/homme et comme il est aimé en retour. Et surtout ceci : homme d’État de cœur et de nature, il se résigne à abandonner le compromis, parce qu’il ne peut y sacrifier son âme… mais pas que. Prêter serment sur la suprématie du roi d’Angleterre sur le pape, c’était le début d’une décadence qu’il ne pouvait publiquement valider au risque d’être un héros.
Car enfin, c’est bien sûr cela le plus bouleversant : le héros, le héros solitaire, celui qu’on aime, mais qui ne peut être compris car il a des siècles d’avance sur le destin de l’Humanité qu’il imprègne. Le héros qui toujours à la fin, meurt seul, sans gloire, ses actes masqués, avec pour compagne l’assurance de ne pas s’être perdu. Je me demande au final, si ce n’est pas la plus belle façon de mourir.
Son : quelque chose de léger et d’impertinent pour casser la lourdeur de ce billet : Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer, Emma Woodhouse, in EMMA. (Original Motion Picture Soundtrack), 2020.