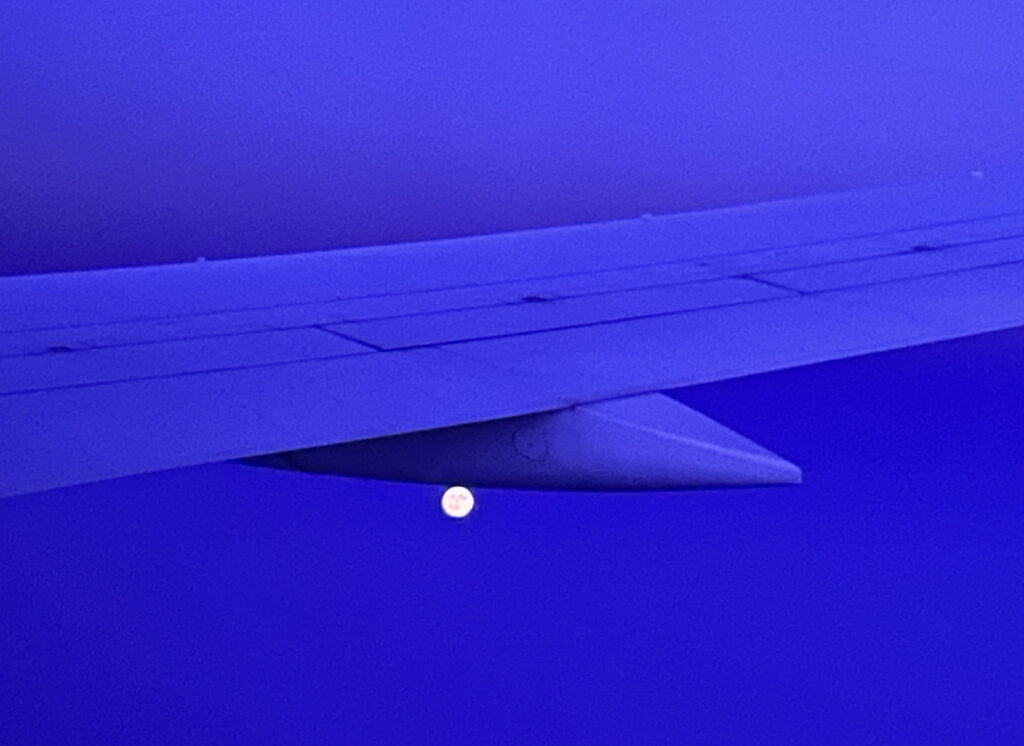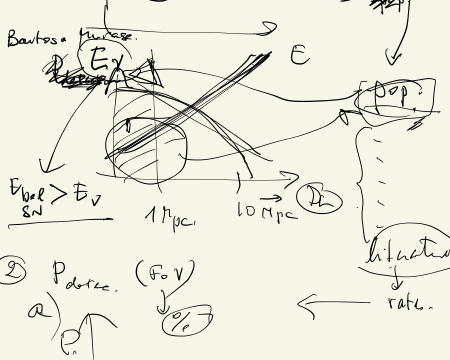Je note pour ne pas oublier : ce début d’automne, orteils gelés dans les ballerines et la caresse grise quand on ouvre les volets, le premier marron et les chemins éculés de l’école.
Je m’entoure au rideau du soir de mes deux petites têtes brunes, bouillottes dans le grand lit, et je leur lis : une heure et demie de Novecento, d’une traite – sur la fin la voix comme une éraflure. Et j’ai bien fait, parce qu’un texte comme ça, ça se prononce à voix haute. Ils rient et ils ont les larmes aux yeux, et nous sommes transatlantiques tous les trois des centaines de fois. Le lendemain, je mets Petrucciani dans la cuisine, et nous nous disons : c’était peut-être un peu comme ça, quand il jouait, Novecento. Je leur lis aussi Ann of Green Gables – en japonais. Et nous allons leur acheter des chaussures en cuir à prix d’or, des cahiers de musique, des pains au chocolat amande et moi un cortado au lait d’avoine. A. me parle de sa nouvelle prof de piano avec un sérieux appréciatif ; une adorable américaine vient avec ses deux petites filles parler anglais aux garçons, au matin je lave et démêle longuement les cheveux d’une poupée de K. avec du Mir Laine. Ils me rappellent Pâques dernier en Pennsylvanie, d’un coup comme s’ils avaient senti le fil tendu, la façon dont ils se connectent à moi, m’entourent et m’aident dans la maison avec discrétion et affection, et se mettent à se tirer eux-mêmes vers le haut. Douce trêve.
O. est dans le Gobi à tester les antennes. Il m’envoie une photo : « Voilà la « Electre’s Room » » pour la prochaine fois où je me joindrai à eux. J’en piaffe d’impatience et je prends patience.
Je sais que maintenant, c’est le moment où l’on se recentre, où l’on se reconstruit dans l’automne et la France, c’est le moment des intensités apaisées où j’abats les tâches jour et nuit, le moment de calme après les mélodrames Netflix de l’été dans la collaboration G., le moment où mon livre s’édite en arrière-plan. Le moment où je pense et prépare la suite. Les suites. Toutes les suites, surtout celles dont je n’ai aucune idée et qui ne se préparent pas. Je consens à tout ce que la vie me réserve. J’espère juste qu’elle y a mis un peu d’écriture.